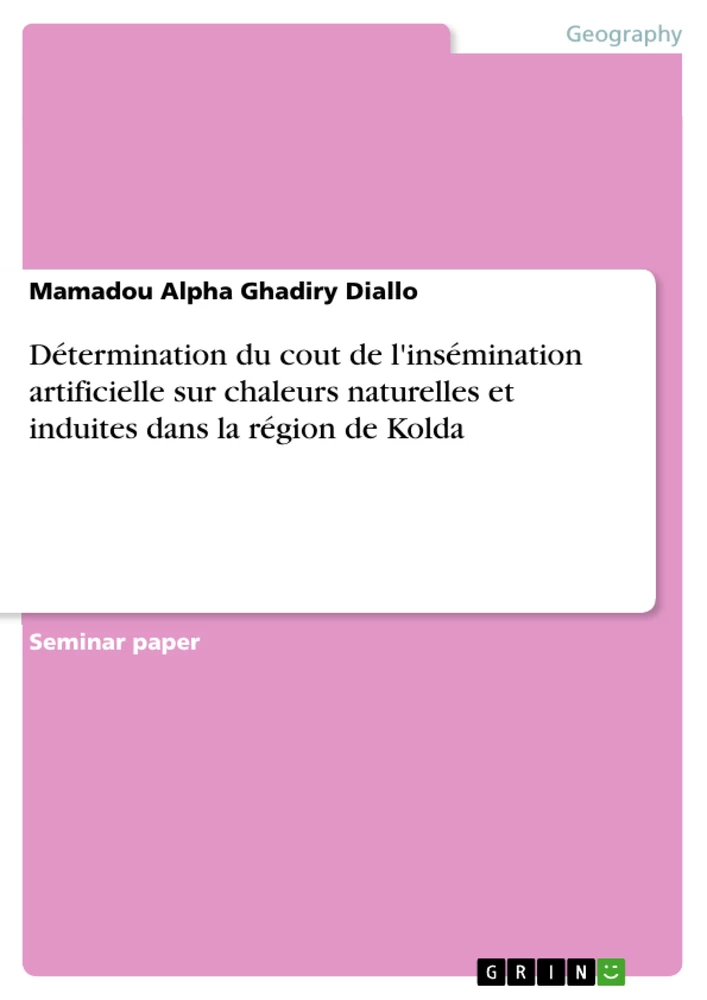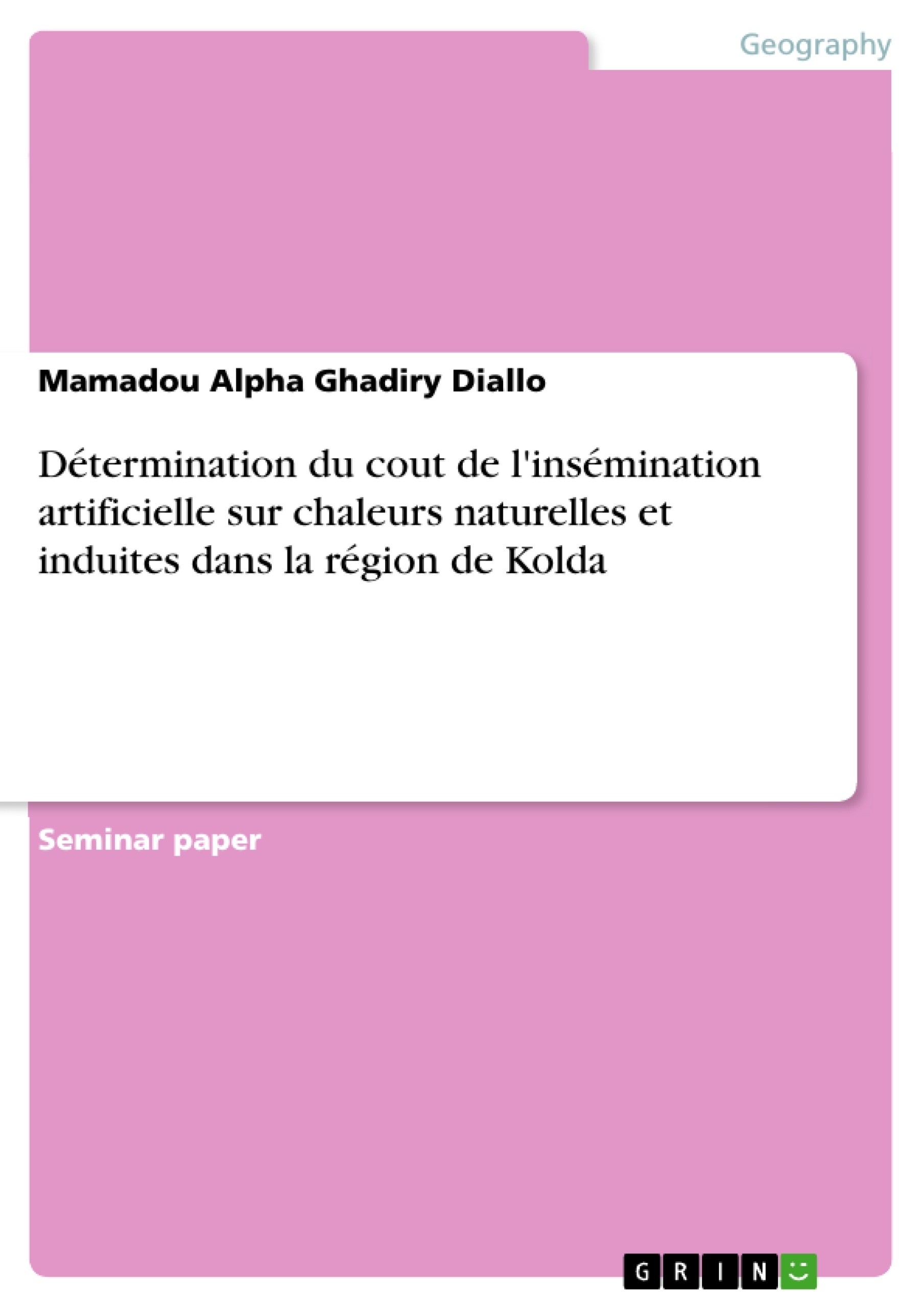En 2012, le marché mondial du lait représentait 631,3 millions de tonnes. Il était majoritairement assuré par l’Asie (26,4%), l’Union Européenne des 27 (24,5%), l’Amérique du Nord et centrale (18,3%) et beaucoup moins par l’Afrique (5,1%). Plusieurs gouvernements africains, ainsi que les organisations régionales, travaillent actuellement sur la manière de mieux veiller à ce que leurs agriculteurs puissent contribuer à une meilleure disponibilité des produits d’élevage de haute qualité ; pour réduire la dépendance aux importations. Dans le même temps, les gouvernements sont de plus en plus conscients du fait que, si l’augmentation de la production de produits d’élevage n’est pas suivie de près, il y aura des conséquences négatives dont l’intensification de la pression sur les ressources naturelles.
Au Sénégal, la contribution du lait local à l’économie nationale est importante. La production s’élève à 120 millions de litres, dont 84% constitués par le lait de vache. Ce lait demeure une composante essentielle du régime alimentaire des populations pastorales ou agro-pastorales, il est aussi une source de revenus pour les éleveurs qui bénéficient d’un débouché régulier (jusqu’à 80 % des revenus annuels). Pourtant, cet héritage culturel semble aujourd’hui « menacé » par le jeu de l’économie du marché. La production laitière locale des pays de l’Afrique occidentale, largement inférieure à la demande nationale, est en effet complétée par les importations massives de poudre de lait. Le Sénégal a importé 40 000 tonnes de lait pour une valeur de 58 milliards de F CFA en 2007, soit environ sept fois le budget du ministère de l’Elevage du pays.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’ELEVAGE ET L’INSEMINATION ARTIFICIELLE BOVINE
CHAPITRE I : situation de l’élevage au Sénégal
1. Races exploitées
1.1 N’Dama
1.2 Zébu Gobra
1.3 Races exotiques
1.4 Les produits issus du croisement
2. Typologie des systèmes de production
3. Contraintes de l’élevage bovin
4. Le défi de l’élevage
CHAPITRE II : rappels physiologiques de la reproduction chez les vaches
1. Cycle sexuel de la vache
1.1 Composante cellulaire
1.1.1 Phase folliculaire
1.1.2 Phase lutéale
1.2 Composante comportementale
1.2.1 Méthodes de détection des chaleurs chez les vaches
1.2.2 Maitrise du cycle sexuel de la vache
1.3 Composante hormonale
CHAPITRE III : PRATIQUE DE L’INSEMINATION ARTIFICIELLE EN AFRIQUE
1. Définition
2. Quelques dates historiques
3. Intérêt de l’IA
4. Modalités de l’IA
4.1 L’IA sur chaleurs naturelles
4.2 L’IA sur chaleurs induites
5. Résultats de l’I.A en Afrique
6. Facteurs de variation de l’IA
6.1 Facteurs liés à l’animal
6.2 Facteurs non liés à l’animal
7. Coût de l’IA en Afrique
7.1 Le prix des intrants
7.2 Le coût de l’IA
DEUXIEME PARTIE : COÛT DE L’INSEMINATION BOVINE AU SENEGAL
CHAPITRE I : MATERIEL ET METHODES
1. Présentation de la région de Kolda
1.2 Projet de Développement de l’Élevage au Sénégal Oriental et en haute Casamance (PDESOC)
2. Matériel
2.1 Matériel animal
2.2 Éleveurs
2.3 Inséminateurs
2.4 Matériel utilisé pour l’étude
2.4.1 Matériel pour l’insémination
2.4.2 Matériel de formation des éleveurs et des inséminateurs
3. Méthodes
3.1Identification, sensibilisation et formation
3.2 Sélection et gestion des chaleurs des vaches à inséminer
3.2.1 Lot 1 sur chaleurs induites
3.2.2 Lot 2 sur chaleurs naturelles
3.3 Insémination proprement dite
3.4 Collecte des données
3.5 Diagnostic de gestation
3.6 Détermination des coûts de l'IA
3.7 Traitement des données
CHAPITRE II : RESULTATS ET DISCUSSION
1. Résultats
1.1 Sélection et gestion des chaleurs
1.1.1 Synchronisation des chaleurs (lot 1)
1.1.2 Détection des chaleurs (lot 2)
1.2 Résultats de l'IA
1.2.1 Lot 1 : IA sur chaleurs induites
1.2.2 Lot 2 : IA sur chaleurs naturelles
1.3 Coût de l'IA
1.3.1 Coût de l'IA sur chaleurs induites
1.3.2 Coût de l'IA sur chaleurs naturelles
1.3.3 Comparaison des coûts de l'IA sur chaleurs induites et naturelles
2. Discussion
2.1 Limites de l’étude
2.2 Gestion des chaleurs
2.2.1 Détection des chaleurs
2.2.2 Synchronisation
2.3 Taux de réussite de l’IA
2.4 Coût de l’insémination artificielle
2.4.1 Composante des coûts
2.4.1.1 coûts des intrants
2.4.1.2 Charge liée au Transport
2.4.1.3 Prestation de services
2.4.2 Coût de l’IA sur chaleurs induites
2.4.3 Coût de l’IA sur chaleurs naturelles
2.4.4 Comparaison des coûts unitaires d’IA sur chaleurs induites et naturelles
RECOMMANDATIONS
CONCLUSION
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
ANNEXE
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à :
Mon père feu Abdoul Ghadiry Diallo,
Ma fille Rahmatoulaye Diallo,
A tous ceux qui partent au lit le ventre vide !
REMERCIEMENTS
Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que sa grâce et sa paix soient sur son Messager Mohamad, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent, vertueusement, jusqu’au jour de la résurrection !
Je remercie la Banque Islamique de Développement (BID) pour avoir financée entièrement mes études de master à l’EISMV.
Je tiens à remercier le Pr Papa El Hassane DIOP pour tout ce qu’il fait et continue à faire pour la jeunesse africaine. C’est une icône et une source d’inspiration pour toute la génération consciente de notre continent.
Je tiens à remercier tout particulièrement mon Directeur de recherche, le Pr Alain Richi KAMGA WALADJO pour avoir initié, encadré et soutenu la réalisation de ce travail. Sa disponibilité, ses brillants conseils et son encadrement de qualité m’ont permis de lever un pan du voile sur mon ignorance. Qu’il trouve ici le témoignage de ma reconnaissance et de mon profond respect.
Toute ma gratitude et remerciements au Directeur général de l’ISSMV de Dalaba : Pr Youssouf SIDIME pour ses conseils et soutien, tout au long de mon séjour à Dakar, et à travers lui, tout le personnel de l’institut de Dalaba.
A ma Mère Rahmatoulaye Diallo. Pour tout ce qu’elle m’a apporté, les valeurs qu’elle m’a apprises ; si j’en suis là aujourd’hui c’est grâce à elle, sache que je suis énormément fier de toi .
A Nenan Issaga pour m’avoir accompagné dans mes premiers pas à l’école.
À ma sœur Marlyatou Diallo. Merci pour tous les conseils qu’elle m’a donné, je suis sûr que la complicité que nous partageons sera toujours présente.
A ma belle-mère Adama Hawa. Pour ses prières, sacrifices et encouragements.
A mon épouse Mariama Djoulde DIALLO. Pour son amour et sa patience. Dès notre première rencontre au Jardin 2 Octobre, je savais qu’on était fait l’un pour l’autre, tu es vraiment extraordinaire. J’espère que j’arriverai à t’apporter tout ce dont tu peux rêver.
Toute ma gratitude et remerciement à ma Tante Halimatou et mes cousins Binta et Fallou Diakhoumpa à Dakar pour leur accueil et encouragements.
Toute ma reconnaissance à ma grande famille de Conakry :
Amadou Tidjane Diallo, Aissatou , Mamadou Saliou, Boubacar, Maimouna, Thierno Oumar, Mariama Cire, Abdoulaye, Houleymatou, Cheikh Sidya, Issaga Bobo, moustapha, Bachir et Abdoul Aziz pour leurs encouragements.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LISTE DES TABLEAUX
Tableau I: Comparaison des paramètres de reproduction des races locales, européennes et métisses
Tableau II: les taux de réussite de l’IA en Afrique de l’Ouest
Tableau III: comparaison des coûts de l’IA sur chaleurs naturelles et induites
Tableau IV: Structure des coûts de l'IA
Tableau V: Comparaison des coûts unitaires de l’IA sur chaleurs induites et naturelles
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Maladies animales suspectées en 2013 et leurs fréquences
Figure 2 : Carte administrative de la région de Kolda
Figure 3 et 4 : formation des éleveurs sur la détection des chaleurs et remise de
téléphone et de carte de crédits.
Figure 5 et 6 : formation et/ou recyclage des inséminateurs.
Figure 7 : Composante en pourcentage des coûts d’un service d’IA sur chaleurs
induites dans la région de Kolda
Figure 8 : Composante en pourcentage des coûts d’un service d’IA sur chaleurs
naturelles dans la région de Kolda, 2014
Résumé
La démocratisation de l’insémination artificielle (IA) ne sera effective que lorsque chaque éleveur aura accès à cette technologie en temps voulu et par ses propres moyens. L’IA sur chaleurs induites reste la modalité la plus plébiscitée au Sénégal. Après vingt ans de pratique, la vulgarisation de cette biotechnologie pose toujours problème, compte tenu de son coût qui est hors de portée des éleveurs . L’IA sur chaleurs naturelles s’avère une alternative pour la démocratisation de l’IA au Sénégal. Pour atteindre cet objectif, le PDESOC a mis en œuvre un protocole pour la comparaison des coûts de l’IA sur chaleurs naturelles et induites, dans la région de Kolda. L’étude a révélé, que le coût de revient d’un service d’IA sur chaleurs induites est de 35 867FCFA contre 22 715FCFA pour l’IA sur chaleurs naturelles, soit une réduction de 13 154FCFA. Dans le cadre du suivi de son exploitation, un éleveur peut réduire ce coût à 20 305FCFA, en investissant seulement, plus de temps dans la détection des chaleurs. Le respect de cette recommandation permet de générer une économie de 15 562FCFA à l’éleveur, soit 43,4% du coût de l’IA sur chaleurs induites. Economiquement, l’IA sur chaleurs naturelles est meilleure, à condition que la zone d’intervention de l’inséminateur soit circonscrite dans un rayon de 15 km dans une zone à forte production laitière. L’éleveur est, dans ce cas précis, le point focal de la réussite de son élevage. Sa capacité à observer les chaleurs est déterminante pour l’adoption définitive de cette modalité d’IA.
Abstract
The democratization of Artificial insemination (AI) will be effective only when each farmer will have access to this timely technology and with its own means. The AI on heat induced remains the most common AI in Senegal. After twenty years of practice, the extension of this biotechnology is still a problem, given that its cost is beyond the reach of farmers. The AI on natural heat turns is alternative for the democratization of AI Senegal. To achieve this goal, the PDESOC implemented a protocol for comparing the cost of AI on natural and induced heat in the Kolda region. In the project, studie have shown that the AI on induced heat costs 35 867F CFA compared to 22 715F CFA for the AI on natural heats, a difference of 13 154FCFA. In and out of the context of the project, a breeder can reduce the cost of AI over natural heat to 20 305F CFA, by only investing more time in heat detection. Compliance with this recommendation generates a profit of 15562F CFA to the breeder, which represents 43, 4% of the cost of AI on induced heat. Economically, IA on natural heat is better, if the inseminator's intervention area is circumscribed within a radius of 15 km. The breeder is the focal point of his successful breeding. His ability to observe the heats is decisive for the final adoption of this modality IA.
INTRODUCTION
En 2012, le marché mondial du lait représentait 631,3 millions de tonnes. Il était majoritairement assuré par l’Asie (26,4%), l’Union Européenne des 27 (24,5%), l’Amérique du Nord et centrale (18,3%) et beaucoup moins par l’Afrique (5,1%). (Hanzen et al., 2013). Plusieurs gouvernements africains, ainsi que les organisations régionales, travaillent actuellement sur la manière de mieux veiller à ce que leurs agriculteurs puissent contribuer à une meilleure disponibilité des produits d’élevage de haute qualité ; pour réduire la dépendance aux importations. Dans le même temps, les gouvernements sont de plus en plus conscients du fait que, si l’augmentation de la production de produits d’élevage n’est pas suivie de près, il y aura des conséquences négatives dont l’intensification de la pression sur les ressources naturelles (Herrero et al., 2014).
Au Sénégal, la contribution du lait local à l’économie nationale est importante. La production s’élève à 120 millions de litres, dont 84% constitués par le lait de vache. Ce lait demeure une composante essentielle du régime alimentaire des populations pastorales ou agro-pastorales, il est aussi une source de revenus pour les éleveurs qui bénéficient d’un débouché régulier (jusqu’à 80 % des revenus annuels). Pourtant, cet héritage culturel semble aujourd’hui « menacé » par le jeu de l’économie du marché. La production laitière locale des pays de l’Afrique occidentale, largement inférieure à la demande nationale, est en effet complétée par les importations massives de poudre de lait. Le Sénégal a importé 40 000 tonnes de lait pour une valeur de 58 milliards de F CFA en 2007, soit environ sept fois le budget du ministère de l’Elevage du pays (Dia, 2010)
L’Etat du Sénégal, pour apporter une solution durable à ce problème récurrent, a initié depuis 1995 de vastes programmes d’amélioration génétique pour intensifier la production locale. L’organisation de campagnes nationales d’insémination artificielle a été identifiée comme étant le meilleur moyen, pour accroitre la production animale. Ces campagnes sont entièrement prises en charge par les pouvoirs publics. Avec comme objectif final, le transfert des charges financières de l’organisation de ces campagnes aux éleveurs de façon progressive dans un avenir proche.
La démocratisation de l’IA ne sera effective que lorsque chaque éleveur pourra accéder à cette technologie en temps voulu et par ses propres moyens. Cependant deux contraintes majeures empêchent l’atteinte de cet objectif. La première est que, depuis la mise en place de l’insémination artificielle bovine en Afrique au Sud du Sahara en général, au Sénégal en particulier, les taux de réussite demeurent toujours faibles par rapport aux taux de référence de 60 à 70 % (Kouamo et al., 2009a).
La deuxième contrainte fait allusion à l’IA sur chaleurs induites qui est la modalité la plus plébiscitée au Sénégal. Néanmoins, cette technique présente des inconvénients parmi lesquels, le coût lié aux intrants. La synchronisation des chaleurs, qui implique l’utilisation d’hormones, a été identifiée comme étant le plus grand poste de dépense durant l’organisation des campagnes. En effet, elle représente 47% des charges totales de l’IA sur chaleurs induites (Ngono, 2007 ; Kouamo et al., 2009a). Cette variable économique constitue sous nos tropiques un facteur limitant pour sa vulgarisation en milieu rural. Une alternative serait d’expérimenter l’IA sur chaleurs naturelles pour offrir ce service de proximité tant souhaité par les éleveurs.
Des études comparatives des deux modalités d’IA ont été réalisées dans le bassin arachidier et la zone Sylvo-pastorale (Hakou, 2006 ; NGono, 2007 ; Kouamo et al., 2009a ; Kalandi, 2011). Pour consolider et renforcer les efforts déjà fournis dans ce sens, il est temps de mener la même étude dans le Sénégal oriental et la haute Casamance, pour mieux analyser les résultats à l’échelle régionale voire nationale.
C’est dans ce cadre que le Programme de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en haute Casamance (PDESOC) a voulu apporter sa contribution, en mettant en œuvre un protocole d’insémination artificielle bovine sur chaleurs induites et naturelles dans la région de Kolda. Dans ce contexte, notre étude a pour objectif général de comparer les coûts de l’insémination artificielle bovine sur chaleurs naturelles et induites.
De façon spécifique, il s’agit de :
- renforcer la capacité des éleveurs en termes de détection de chaleurs
- comparer les résultats des IA sur chaleurs induites et naturelles
- déterminer le coût unitaire de l’IA sur chaleurs induites et naturelles
- comparer les coûts des IA sur chaleurs induites et naturelles ainsi que les contraintes.
Pour atteindre ces objectifs, ce travail comporte deux parties :
La première partie est consacrée à la situation de l’élevage au Sénégal, aux notions de physiologie de la reproduction, de pratique d’insémination artificielle bovine ainsi que la présentation de quelques résultats en Afrique. La seconde partie, met en relief le matériel et les méthodes utilisés, les résultats obtenus, la discussion de ces derniers, les recommandations et les perspectives.
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR L’ELEVAGE ET L’INSEMINATION ARTIFICIELLE BOVINE
CHAPITRE I : Situation de l’élevage au Sénégal
1. Races exploitées
1.1 N’Dama
Appartenant à l’espèce Bos taurus, la présence du bovin N’Dama en Afrique de l’Ouest a été confirmée par plusieurs auteurs (Bouyer, 2006). La particularité de cette race vient surtout de sa taille (0,95-1m), sa robe généralement fauve, ses petites cornes en forme de lyre, sa rusticité et sa trypanotolérance. Sa production de viande et de lait est plus ou moins appréciable (Kamga, 2002 ; Diadhiou, 2001 ; Pousga, 2002). La puberté chez la vache N’Dama serait atteinte aprés 2 ans (Tableau I) avec un poids inférieur à 200kg. L’intervalle vêlage-vêlage est de 18 à 50 mois selon l’environnement. Sa mise en reproduction est recommandée après 2 ans (Bouye r, 2006).
1.2 Zébu Gobra
Le zébu Gobra se caractérise par sa robe blanche ou grise. Sa taille peut atteindre 1,40m. Ses aptitudes bouchères sont plus appréciées que sa potentialité laitière. L’âge au premier vêlage de cet animal est de 4 à 5 ans (Tableau I), avec un intervalle vêlage-vêlage de 15 à 24 mois, selon le système d’élevage (Bouyer, 2006).
1.3 Races exotiques
Un nombre important de races a été importé par l’Etat du Sénégal et certains privés pour améliorer de façon significative la production laitière. Parmi ces races on peut citer : la Holstein, la Montbéliarde, la Jersiaise (Ngono, 2007). Le haut potentiel laitier est le point commun de ces races.
1.4 Les produits issus du croisement
Les produits issus du croisement entre les races locales et exotiques ont affiché de meilleures performances. La production laitière est de 5 à 6 fois supérieure à celle de la race locale. L’âge moyen au premier vêlage au Sénégal est de 47 mois (Tableau1) pour les métis contre 60 et 47mois respectivement pour le zébu Gobra et la race N’Dama. La croissance pondérale des bovins croisés (400kg) est meilleure par rapport aux races locales (250kg) (Bouyer, 2006). Ce qui fait que ces races croisées sont mises en reproduction bien avant les races locales. Généralement les métis sont plus exigeants sur le plan alimentaire, et de suivi sanitaire. Cette situation pourrait constituer un facteur limitant pour l’extériorisation de leur potentiel génétique. En apportant des changements dans les pratiques d’élevage, cette production pourrait être améliorée. Comme pour dire que les systèmes d’élevage pratiqués constituent un facteur de variation pour la production des métis.
Tableau I: Comparaison des paramètres de reproduction des races locales, européennes et métisses
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Source : modifiée de Bouyer, 2006
2. Typologie des systèmes de production
Les systèmes pastoraux occupent la majeure partie de la superficie des terres et ont généralement de faibles densités de population humaine avec des taux plus élevés de ruminants par rapport aux humains (le Ferlo). Les systèmes mixtes culture-élevage, sont situés dans des zones appropriées à la fois pour la production agricole et l’élevage et où la densité de la population humaine est plus élevée (le centre-Nord du bassin arachidier, la vallée du fleuve Sénégal, la zone Sud et Sud-Est du Sénégal). Les systèmes intensifs, généralement sont localisés dans les zones péri-urbaines/urbaines et les systèmes sans terre que l’on retrouve souvent en zones urbaines, comme la Zone des Niayes et dans la région de Thiès. (NISDEL, 2004, Herrero et al., 2014).
3. Contraintes de l’élevage bovin
La littérature est homogène en ce qui concerne le climat, la génétique et la faiblesse de la couverture sanitaire contre les maladies endémiques (figure2), comme étant des contraintes majeures pour la production et la reproduction de nos races (Sawadogo, 1998 ; Kamga, 2003 ; Amou’ou, 2005, Bouyer, 2006). Ces contraintes expliquent en partie la faible productivité de nos races. La poudre de lait importé, fait de l’ombre à la production locale. Le vol de bétail, bien que négligé par la littérature, n’est pas en reste, surtout pour l’élevage extensif.
4. Le défi de l’élevage
L’alimentation est capitale dans la production animale. L’amélioration consisterait en la mise en réserves de sous-produits agricoles tels que les résidus de récolte (ex : fane d’arachide), les graines de coton et les tourteaux d’arachide. Les fanes de légumineuses (arachide, niébé), de racines et de tubercules présentent des qualités plus favorables que les pailles de céréales lorsque les résidus sont correctement récoltés et conservés. Les graines de coton ont une valeur nutritive aussi bonne que les meilleurs fourrages de légumineuses. De plus ces sous-produits sont facilement transportables et conservables à longue durée Des techniques de conservation des fourrages comme le fanage, l’ensilage ou le traitement à l’urée pourraient être enseignées aux éleveurs pour disposer d’aliments pendant la saison sèche (Bouyer, 2006). La couverture vaccinale et la capacité d’adoption des technologies doit être renforcée, de façon permanente. L’Etat, à travers une politique incitative, doit accompagner les acteurs de l’élevage pour une meilleure valorisation des produits sur le marché. Il doit également mener une politique pour faciliter l’accès des éleveurs au crédit sans intérêt, dont le payement sera basé sur le partage des intérêts et des pertes. Il est important de faciliter l’accès des éleveurs au foncier, surtout pour les femmes à travers une politique de discrimination positive. Le vol de bétail, malgré le durcissement de la loi pénale, continue toujours à appauvrir et à décourager les éleveurs. La stabulation est une nécessité pour réduire le vol, mais aussi pour un meilleur encadrement et suivi des éleveurs et du cheptel. C’est en ce moment seulement que l’IA pourra générer de meilleurs résultats. Les charges liées à l’organisation des campagnes nationales de l’IA doivent être transférées aux éleveurs de façon progressive en allégeant la pression des coûts. Pour permettre à chaque éleveur de faire recours à cette technologie en temps voulu. Et par ses propres moyens. La production de la semence sexée est une option pour atteindre plus rapidement l’autosuffisance en produit laitier. Cette option permettra de réduire de façon drastique la supériorité des mâles parmi les F1 dont l’objectif principal est la production laitière. Elle permettra également d’éviter les croisements anarchiques et de renforcer la capacité des prestataires dans le domaine de l’amélioration génétique. D’où l’importance de renforcer les capacités d’intervention du Centre National d’Amélioration Génétique (CNAG).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 1: Maladies animales suspectées en 2013 et leurs fréquences (MEPA, 2013)
CHAPITRE II : Rappels physiologiques de la reproduction chez les vaches
1. Cycle sexuel de la vache
Chez les mammifères, dès la puberté, l’appareil génital femelle présente des modifications morphologiques et physiologiques. Le cycle sexuel peut s’apprécier selon trois composantes : cellulaire, comportementale et hormonale.
1.1 Composante cellulaire
1.1.1 Phase folliculaire
Caractérisée par la sécrétion de l’œstrogène par les cellules de la thèque interne des follicules ovariens, la phase folliculaire est représentée par deux étapes qui se suivent de façon chronologique : le pro-oestrus et l’oestrus.
- Pro-oestrus
Il correspond à la période de croissance folliculaire qui amène un follicule du stock cavitaire au stade de follicule mur destiné à ovuler. Cette croissance se fait par un phénomène de vagues folliculaires successives, qui sont en moyenne de 2 à 3 cycles. C’est également pendant cette période que se termine la lyse du corps jaune. Cette étape a une durée d’environ de 2 à 4 jours chez la vache (Hakou, 2006).
- Oestrus
La femelle présentera donc un ensemble de signes comportementaux, pour les uns accessoires et sujets à d'importantes variations individuelles et sociales en relation notamment avec le rang hiérarchique occupé par l'animal au sein du troupeau, pour les autres caractéristiques de l'état d'acceptation du mâle (Hanzen, 2015-2016). La durée de l’oestrus chez les zebu est 12,20±1,30h, avec des valeurs extrêmes de 11h et 14h (Pitala et al., 2012). Chez la race N’Dama elle est de 11h03±2. Pour le zébu Gobra elle est de 16 heures (Bouyer, 2006).
1.1.2 Phase lutéale
Cette phase caractérisée par l’entrée en fonction du corps jaune, comporte deux étapes : le met-oestrus et le di-oestrus
Met-oestrus
Le met-oestrus, encore appelé post-oestrus correspond à la période de formation de corps jaune. Après l’ovulation, le follicule rompu devient le siège de remaniement cytologique et biochimique qui conduit à la formation du corps jaune. Elle a une durée de 4 jours chez la vache (Hakou, 2006).
- Di-oestrus
C’est la période de fonctionnement du corps jaune, avec l’installation d’un état pré-gravide par le biais de la progestérone. Cette phase dure environ 10 à 15 jours chez la vache. En absence de fécondation, la lyse du corps jaune sous l’effet de la prostaglandine marque la fin de cycle (Hakou, 2006)
1.2 Composante comportementale
La vocation naturelle de l’oestrus est le rapprochement des deux partenaires sexuels. Celui-ci comporte dans un premier temps la recherche de ce partenaire, puis dans un second temps l’apparition d’une réponse posturale caractéristique de l’accouplement. Pendant la période de l’acceptation du chevauchement, une vache sera susceptible d’accepter jusqu'à 55 chevauchements (Hanzen, 2015).
1.2.1 Méthodes de détection des chaleurs chez les vaches
La détection des chaleurs est une étape clé de la mise à la reproduction dans les exploitations bovines où l’IA est pratiquée. Elle résulte de deux composantes : le niveau d’expression des chaleurs par les vaches et les pratiques mises en œuvre par l’éleveur pour les détecter (Chanvallon, et al., 2012). Dans le cadre optimal, le taux de détection des chaleurs doit être de 80% (Brassard et al., 1997). Les années d’expériences et la vigilance des éleveurs sont des facteurs à prendre en compte (Kouamo et al., 2009b). Les chaleurs courtes et discrètes (Pitala et al., 2012 ; Chanvallon et al., 2012 ; Diop et al., 1998), la température et l’alimentation (Sawadogo, 1998 ; Amou’ou, 2005 ; Bouyer, 2006) et la distribution nycthémérale des chaleurs. (Diop et al., 1998 ; Hanzen, 2015-2016) ont été identifiées, par plusieurs auteurs, comme des facteurs majeurs de variation de l’expression des oestrus. La détection des chaleurs est une activité incontournable pour la pratique de l’IA sur chaleurs naturelles. Elle est simplement recommandée pour l’IA sur chaleurs induites. Deux méthodes d’observation ont été citées dans la littérature : l’observation directe et indirecte.
- Observation directe
L'intensité et la durée de l'acceptation du chevauchement (standing heat), en est le signe caractéristique (Hanzen, 2015-2016). Ainsi, une détection des chaleurs basée exclusivement sur ce signe peut conduire à de bons résultats si la surveillance des animaux est élevée mais elle devient une pratique à risque si la fréquence d’observation est trop faible. L’acceptation du chevauchement reste le signe le plus spécifique de l’œstrus mais il est rare. Intégrer les signes sexuels secondaires dans sa pratique de détection des chaleurs est indispensable pour augmenter ses chances de détecter une femelle en chaleurs. Cependant, ces signes étant moins spécifiques, la recommandation actuelle consiste à repérer la répétition de ces signes : une vache qui exprime au moins 3 signes sexuels secondaires sur une période d’observation est considérée en chaleurs. Hanzen (2015-2016), conseille l’éleveur de consacrer, matin et soir, au maximum 30 minutes de son temps à la détection des chaleurs. Une double période d'observation lui permettra de détecter 88% des chaleurs.
Observation indirecte
Cette méthode d’observation nécessite l’utilisation de dispositif de révélateur de chevauchement. Ce dispositif peut être un marqueur (Kamar), ou un dispositif électronique (heat watch) ou un podomètre ou une caméra de surveillance. Sur le plan de l’efficacité, certains auteurs, encouragent une combinaison de l’observation visuelle et la mise en place de ces dispositifs pour aboutir à de meilleurs résultats (Hanzen, 2015-2016). Une amélioration des outils automatisés de détection des chaleurs et l’identification de Quantitative Trait Loci (QTL) relié à l’expression des chaleurs doivent être des perspectives d’avenir.
1.2.2 Maitrise du cycle sexuel de la vache
Pour faciliter l’observation des chaleurs et l’utilisation de l’IA, plusieurs traitements ont été proposés aux éleveurs. Le traitement hormonal reste le plus pratiqué dans les élevages. Les produits utilisés sont des hormones sexuelles ou leurs dérivées, seules ou en association. Il s’agit, des prostaglandines, des progestagènes, et des gonadotrophines. Pour la synchronisation et l’induction des chaleurs, Le PRID et le CRESTAR sont les plus sollicités sous nos tropiques.
1.3 Composante hormonale
Le complexe hypothalamo-hypophysaire, l’ovaire et l’utérus de par leurs sécrétions assurent la régulation hormonale du cycle sexuel de la vache. Quand le corps jaune régresse à la fin du cycle (du 15ème au 19ème jour du cycle) l’utérus produit des prostaglandines qui entrainent la lyse du corps jaune. Le rétrocontrôle négatif, exercé par le corps jaune par le biais de la progestérone, est levé progressivement. La GnRH stimule la synthèse hypophysaire de la FSH qui assure le recrutement, ainsi que le début de la croissance de plusieurs follicules, induisant ainsi une forte augmentation de 17-β-œstradiol plasmatique (à l’origine du comportement de chaleurs). L’augmentation de la décharge d’œstrogène induit une rétroaction positive sur la production de GnRH et donc de LH., provoquant l’ovulation et la formation du corps jaune (Brassard, 1997 ; Hakou, 2006 ; Chicoineau, 2007).
CHAPITRE III : PRATIQUE DE L’INSEMINATION ARTIFICIELLE EN AFRIQUE
1. Définition
L’insémination artificielle est un outil biotechnologique de la reproduction de première génération, qui consiste à féconder une femelle en déposant, au moment des chaleurs, la semence collectée et conditionnée, issue de l’appareil génital mâle; dans la partie la mieux indiquée des voies génitales femelles à l’aide d’un pistolet inséminateur.
2. Quelques dates historiques
Les arabes revendiquent la première application de l’IA chez les juments en 1332 . En 1779, le physiologiste italien, Lauro Spallanzani réalisa la première insémination artificielle chez l’espèce canine. Chez les bovins par contre, les premiers essais ont été réalisés au début du 20e siècle, avec notamment l’équipe russe d’Ivanov (1907), l’équipe danoise de Sand et Rowenson (1935) et les Etats Unis en 1938. L’IA a pris son essor avec le travail de l’équipe de Cassou et Laplau à Rambouillet (France) sur les techniques de dilution et de conservation de la semence. En 1952, Polge revendique les premiers résultats de l’IA avec du sperme congelé à -79°C. En Afrique, les premiers essais ont été réalisés au Kenya avec l’équipe d’Anderson en 1935 (Kouamo et al., 2009b ; Hanzen, 2015-2016)
3. Intérêt de l’IA
L’IA présente plusieurs avantages qui sont d’ordre sanitaire, technique, pratique, génétique et économique. C’est un outil de prévention de la propagation de maladies contagieuses et/ou vénériennes. Elle permet d’exploiter des reproducteurs performants souffrant d’impotence à la suite d’accident ou d’engraissement. Grace à l’IA, les problèmes de fertilité des animaux sont détectés de façon précoce. Elle permet aussi une diffusion rapide du progrès génétique en testant sur descendance la valeur génétique des taureaux avant leur acceptation dans les centres de production de semences. Elle offre également à l’éleveur un choix multiple de reproducteur en fonction de ses besoins. L’IA a permis, d’autre part, de renoncer au géniteur au profit des paillettes de semence. Les taureaux, issus de cette technologie, sont généralement orientés vers la production de viande. En Afrique, l’IA a permis de multiplier la production de 5 à 6 fois en milieu rural. Ce qui constitue une source de revenu non négligeable pour les éleveurs (Bouyer, 2006, H anzen, 2015-2016).
4. Modalités de l’IA
4.1. L’IA sur chaleurs naturelles
Cette modalité encourage la pratique de l’IA basée sur la détection des chaleurs. Deux conditions sont fondamentales pour la réussite de cette méthode : l’expression des chaleurs par la vache et la vigilance de l’éleveur. Dans ce cas l’éleveur à une part active dans la reproduction de son cheptel. Contrairement aux pays européens, cette modalité n’est pas adaptée au système extensif, majoritairement pratiqué en Afrique. Considérant le coût de l’IA sur chaleurs induites, beaucoup de pays africains comme le Cameroun (Messine et al., 2003) et le Sénégal (Kouamo et al, 2009a; Ngono, 2006) sont devenus des adeptes de cette méthode. Néanmoins, il faut reconnaitre que la détection des chaleurs par les éleveurs est un challenge.
4.2. .L’IA sur chaleurs induites
L’IA sur chaleurs induites est la modalité la plus pratiquée sur le continent africain. Cette pratique nécessite l’utilisation des hormones pour la synchronisation et l’induction des chaleurs. Le PRID (Diadhiou, 2001 ; Hakou, 2006 ; Kouamo et al, 2009) et le CRESTAR (Messine et al, 1993 ; Diop et al., 1998 ; Humblot et al., 1996; Chicoineau, 2007 ; Pitala et al., 2012) sont des protocoles de choix sous nos tropiques. Ces traitements à base de progestagène sont le plus souvent associés à des injections d’ECG et/ou de prostaglandine F2α selon le protocole.
5. Résultats de l’I.A en Afrique
Depuis la mise en place de l’insémination artificielle bovine en Afrique au Sud du Sahara et au Sénégal en particulier, les taux de réussite demeurent toujours très faibles par rapport aux taux de référence de 60 à 70 % (Kouamo et al., 2009b). Le Tableau II met en évidence les résultats de l’IA en fonction des pays et la période d’étude. Plusieurs facteurs peuvent influencer ces résultats.
Tableau II: les taux de réussite de l’IA en Afrique de l’Ouest
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Facteurs de variation de l’IA
La bibliographie est hétérogène en ce qui concerne les facteurs qui peuvent influencer les résultats de l’IA, surtout en milieu rural. Certains facteurs sont liés à l’animal et d’autres non.
6.1 Facteurs liés à l’animal
L’âge, la note d’état corporelle, la période post-partum, l’état sanitaire de l’animal, sont des facteurs qui peuvent influencer le taux de réussite de l’IA (Kamga, 2003 ; Butler, 2005 ; Amou’ou, 2005 ;; Kouamo et al, 2009b).
6.2 Facteurs non liés à l’animal
L’alimentation, la température, la qualité des chaleurs détectée par les éleveurs et l’inséminateur et son équipe sont des facteurs majeurs de variation des résultats de l’IA (Brassard et al., 1997 ; Sawadogo, 1998 ; Kamga, 2003; Bouyer, 2006 ; Hakou, 2006).
7. Coût de l’IA en Afrique
7.1 Le prix des intrants
L’importation a toujours impacté sur le prix de revient des intrants. Avec une tendance de variation en fonction de l’année et du pays. Pousga (2002), note une valeur de 3422 F au Mali contre 6000F au Sénégal (Diakhoumpa, 2003). Kouamo et al., (2009b) parlent de 6500F et. Le prix de l’azote liquide, indispensable pour la conservation de la semence, est aussi variable que la semence. Bouyer, 2006 rapporte une valeur de 4000F pour le Sénégal et 3000 au Burkina-Faso. Le prix des hormones (la spirale, la prostaglandine et le PMSG), pour l’induction et la synchronisation des chaleurs, s’inscrit sur la même tendance de variation. Il est fort probable que les prix de ces hormones resteront élevés durant les prochaines années à cause de la généralisation de l’agriculture biologique (AB) en perspective.
7.2 Le coût de l’IA
Le coût de cette technologie reste toujours inaccessible pour bon nombre d’éleveurs. Les campagnes nationales d’IA sont entièrement financées par le pouvoir public (Tableau III).
Tableau III: comparaison des coûts de l’IA sur chaleurs naturelles et induites (passage unique)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
DEUXIEME PARTIE : COÛT DE L’INSEMINATION BOVINE AU SENEGAL
CHAPITRE I : MATERIEL ET METHODES
1. Présentation de la région de Kolda
La région de Kolda est située à l’extrême Sud du Sénégal entre le 12°20 et 13°40 de latitude Nord, et les 13° et 16° de longitude Ouest. Elle est limitée au Nord par la République de Gambie, au Sud par les Républiques de Guinée et de Guinée-Bissau, à l'Est par la région de Tambacounda et à l'Ouest par la région de Sédhiou (Fig 2). Sa population est estimée à 633 675 habitants en 2013 pour une superficie de 13 771 km² soit une densité de 46 habitants au km² (RGPHAE, 2013). Elle est subdivisée en trois départements : Kolda, Vélingara et Madina Yéro Foula.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 2: Carte administrative de la région de Kolda (propriété de l’auteur)
Son climat est de type soudano-guinéen, chaud et humide, avec une température variant entre 25 et 40°C. Kolda est caractérisée par des précipitations qui varient entre 700 et 1300 mm et qui s'étalent de juin à octobre. Elle dispose d'une végétation abondante. Les peuls constituent l'écrasante majorité de la population avec une tradition agropastorale bien établie. La population est très jeune (60%) avec un taux de croissance démographique de 2,4 %. Son économie est principalement axée sur l'agriculture. Kolda est la deuxième région agricole du Sénégal. Les aptitudes de la région à la production agricole reposent sur ses vastes espaces cultivables et sur l'abondance de la pluviométrie. La région présente une diversité de production : la céréaliculture (maïs, mil, riz, sorgho, fonio), les cultures de rentes avec l'arachide qui représente ¾ de la production (arachide, coton, sésame), et les tubercules (manioc, patate douce), le maraîchage, et les cultures fruitières. L'élevage est de type extensif sédentaire. Les espèces élevées dans la région de Kolda sont pour la plupart les bovins, essentiellement composées de la race N'Dama et de quelques métis. Avec un cheptel bovin évalué à 461 870 têtes, la capacité de production laitière de la région de Kolda est de 529 255 litres (ANSD, 2013). Pour améliorer la production locale, le Projet de développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en haute Casamance (PDESOC) a été mise en place en 2011 pour une durée de 5 ans
1.1 Projet de Développement de l’Élevage au Sénégal Oriental et en haute Casamance (PDESOC)
Financé par la BID (56%), la BADEA (33%) et l’Etat du Sénégal (11%), le PDESOC intervient dans les zones de Kolda, Tambacounda et Kédougou. Ce projet a comme objectifs de réduire la pauvreté, améliorer la productivité et garantir la sécurité alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, une feuille de route a été élaborée par le projet ; il s'agit de:
- l'appui à la production par le développement des infrastructures rurales et l’amélioration de la productivité de l’élevage ;
- la création de l'emploi, la contribution à l'augmentation et à la diversification des ressources ;
-l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et l’allègement des travaux des femmes à travers l'approvisionnement en eau potable ;
- le développement de la filière laitière locale par le biais de l’amélioration génétique.
2. Matériel
2.1 Matériel animal
Les vaches N'Dama cyclées et issues des élevages semi-intensifs de la région de Kolda ont été sélectionnées. Sur 381 vaches présentes à la sélection, 200 vaches ont été retenues et réparties en deux lots pour la réalisation des inséminations sur chaleurs naturelles (100 vaches) et sur chaleurs induites (100 vaches).
2.2 Éleveurs
Les éleveurs retenus doivent respecter la stabulation, nourrir les vaches en enclos, respecter le rendez- vous, détecter les chaleurs et appeler l'inséminateur lorsque les inséminations se font sur chaleurs naturelles.
2.3 Inséminateurs
Des contrats ont été faits avec des inséminateurs privés disponibles, capables de mener des inséminations quotidiennes dans un rayon de 30 à 50 km. 4 prestataires, à raison d'un inséminateur pour 50 vaches, ont été retenus pour l’étude.
2.4 Matériel utilisé pour l’étude
2.4.1 Matériel pour l’insémination
Dans le cadre de l’insémination artificielle, un certain nombre de matériel classique a été utilisé. Il s’agit de:
1. Pistolet de Cassou et accessoires stériles
2. La semence congelée, utilisée dans notre étude provient de deux taureaux d’élite sélectionnés (Remanso et Beauli).
3. Bombonne d’azote
4. Gaines protectrices
5. Chemises sanitaires
6. Pinces
7. Ciseaux
8. Thermos pour la décongélation de la semence et un thermomètre
9. Serviettes
10. Gants de fouille
11. Gel lubrifiant
2.4.2 Matériel de formation des éleveurs et des inséminateurs
La formation des éleveurs a été orale, tandis que celle des inséminateurs a nécessité l'utilisation d'ordinateur, de vidéoprojecteur, d’utérus de vaches isolés et de vaches sur pieds.
3. Méthodes
Les travaux de terrain se sont déroulés presqu'entièrement dans la saison sèche allant du mois de février au mois de juillet 2014. L'objectif est de comparer le coût unitaire de l’insémination artificielle sur chaleurs induites et naturelles. Pour atteindre cet objectif plusieurs activités ont été menées dans la région de Kolda sous le couvert du PDESOC.
3.1Identification, sensibilisation et formation
Les agents de l’État, les inséminateurs et les éleveurs ont, à cette occasion, été informés et sensibilisés sur les objectifs du projet. C’est ainsi que nous avons partagé avec les acteurs les critères de participation au projet ainsi que les résultats attendus.
Parmi les critères de participation :
- l'éleveur doit être résident dans la zone d'étude, membre d'une OP et fournisseur d’une laiterie ;
- l'éleveur doit avoir un esprit d'équipe et s'adapter aux conditions en termes de conduites d'élevage, de stabulation de complémentation et de suivi sanitaire du troupeau ;
- l'éleveur doit participer à la formation sur les techniques d'observation des chaleurs ;
- la ferme ou l'exploitation doit être d’accès facile.
Les éleveurs d'un même village doivent regrouper les vaches sélectionnées dans un enclos 2 fois par jour (matin et soir) pour détecter les chaleurs, appeler l’inséminateur dès l'observation des manifestations de chaleurs sur au moins 1 vache.
Pour la formation, la méthode pratique en langue nationale (Pular et Wolof) a été privilégiée (Figure 3). Elle s'est déroulée sur les différents sites retenus en commun accord avec les éleveurs dont les vaches ont été déclarées éligibles selon les critères de sélection. Pour détecter les chaleurs avec plus de certitude, un accent particulier a été mis sur l'acceptation du chevauchement comme principal signe par rapport aux autres qui ne sont pas sans intérêt. Un téléphone portable et une carte de crédit (Figure 4) ont été mis à la disposition de chaque éleveur admis dans le projet. Les formateurs n'ont pas manqué de rappeler aux bénéficiaires que la disponibilité à respecter le temps d'observation et la promptitude à joindre l'inséminateur sont les deux conditions nécessaires, pour la réussite de cette expérimentation. La formation ou le recyclage des inséminateurs a concerné des auditeurs vétérinaires et agents d’élevage du public et du privé (Figure 5 et 6). Les inséminateurs disponibles doivent être capables de gérer les opérations d’insémination sur chaleurs naturelles et induites simultanément. Les agents de l’Etat, quant à eux, ont été entretenus sur la collecte des données, les étapes des différentes activités, l’encadrement des éleveurs et leur relation avec les éleveurs et les inséminateurs.
Figure 3Figure 3 et 4 : formation des éleveurs sur la détection des chaleurs et remise de téléphone et de carte de crédits.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 4 Figure 5 et 6 : formation et/ou recyclage des inséminateurs.
3.2 Sélection et gestion des chaleurs des vaches à inséminer
Lors de la sélection des animaux, une fouille rectale a été effectuée pour sélectionner les vaches non gestantes et cyclées, qui se traduit par une certaine activité ovarienne. Compte tenu de la saison, sur une échelle de 0 à 5 (Val l et Bayala, 2004), seuls les animaux qui ont une NEC ≥ à 2 seront choisis pour mener cette étude. Après la sélection, les animaux sont identifiés avec des boucles auriculaires. Une complémentation alimentaire a été recommandée pour tous les animaux sélectionnés. Ces vaches ont été réparties en 2 lots suivant les méthodes d'IA (chaleurs naturelles et induites).
3.2.1 Lot 1 sur chaleurs induites
Un mois après la sélection, tous les animaux destinés à l'insémination artificielle sur chaleurs induites, ont été soumis à la synchronisation. Le protocole utilisé est le suivant:
J0 → Pose du dispositif intra-vaginal contenant 1,55g de progestérone (PRID Delta)
J8→ injection de prostaglandine F2α (Enzaprost T, 25mg)
J9→ retrait PRID Delta et injection de 500UI de PMSG
J11→ chaleurs puis insémination 56 heures après le retrait du PRID Delta.
3.2.2 Lot 2 sur chaleurs naturelles
Il a été convenu avec les éleveurs concernés d'un même village de regrouper les vaches 2 fois par jour (matin et soir) pour la détection des chaleurs. Une fois les chaleurs observées (acceptation du chevauchement), l'éleveur identifie la vache et informe immédiatement l’inséminateur par téléphone.
3.3 Insémination proprement dite
Pour la réalisation de l'insémination, 4 inséminateurs ont été recrutés par le projet. Les inséminations sur chaleurs induites sont effectuées 56 heures après le retrait du dispositif intra-vaginal. Tandis que pour les IA sur chaleurs naturelles la règle du matin et soir est appliquée. C'est à dire que les vaches vues en chaleurs le matin ont été inséminées le soir et inversement. La méthode recto-vaginal a été choisie pour inséminer les vaches sélectionnées. Le nombre d'IA, pour des raisons d’efficience, a été limité à un service par vache.
3.4 Collecte des données
Des fiches ont été élaborées pour recueillir des données sur l'animal (race, âge, période post-partum, poids , état ovarien et corporel, les signes de chaleurs), sur le moment de réalisation des différentes opérations, sur le propriétaire de l'animal et sur l’inséminateur.
3.5 Diagnostic de gestation
Le diagnostic de gestation a été réalisé 2 mois après l'acte d'IA par exploration rectale. Ce diagnostic permettra d’évaluer le taux de gestation.
3.6 Détermination des coûts de l'IA
Nous avons considéré un effectif de 200 têtes inséminées (à raison d'un service par vache) sur chaleurs induites (100) et naturelles (100). Les animaux ont été répartis en 10 lots de 10 vaches sur une distance moyenne de 15 km entre le prestataire et chaque lot. Pour les besoins de déplacement, une voiture tout terrain a été utilisée dont la consommation a été évaluée à 10 L/100 km. Le prix du carburant était de 792F au moment de l'étude. Concernant les appels, nous avons pris en compte l'amortissement du téléphone en 3 mois et les crédits. Le coût de la prestation a été fixé à 12000F. Ce coût couvre les frais de la sélection (2000F), de la synchronisation (5000F) et l’acte d’IA proprement dite (5000F). Pour les consommables (synchronisation et insémination), nous nous sommes référés aux prix appliqués sur le marché. Les charges ont, pour faciliter les calculs, été subdivisées en 4 postes de dépenses : la sélection, la synchronisation, l'IA proprement dite et le diagnostic de gestation.
3.7 Traitement des données
Après la collecte des données, elles ont été saisies sur un tableur Excel. Le traitement et l'analyse des données ont été effectués sur le même tableur tout en considérant les 4 postes de dépenses.
CHAPITRE II : RESULTATS ET DISCUSSION
1. Résultats
1.1 Sélection et gestion des chaleurs
La sélection a concerné 381 têtes de la race N'Dama. A l'issue de cette activité, 200 vaches ont pu être admises dans le cadre du projet, soit un taux de sélection de 52,49%. Cet effectif de 200 vaches a été reparti en 2 lots de 100 vaches pour être inséminé sur chaleurs induites (lot 1) et naturelles (lot 2).
1.1.1 Synchronisation des chaleurs (lot 1)
100 vaches sélectionnées ont été soumises à la synchronisation des chaleurs. Aucune perte de spirales n'a été enregistrée. Les vaches sont venues en chaleurs 44 heures après le retrait du dispositif intra- vaginal, soit un taux de synchronisation de 100%.
1.1.2 Détection des chaleurs (lot 2)
Sur un effectif de 100 vaches sélectionnées, 85 vaches ont été observées en chaleurs par les éleveurs. Parmi ces 85 il n'y a eu que 23 qui ont été confirmées par l'inséminateur soit un taux de détection de 27,05%.
1.2 Résultats de l'IA
Au total, ce sont 185 vaches qui ont été inséminées. Ce chiffre est reparti en fonction des 2 lots de façon inégale.
1.2.1 Lot 1 : IA sur chaleurs induites
Parmi les 100 vaches inséminées sur chaleurs induites, 80 étaient présentes lors du diagnostic de gestation. Après le DG, 37 vaches étaient gestantes soit un taux de gestation de 46,25%.
1.2.2 Lot 2 : IA sur chaleurs naturelles
Dans ce lot, sur 85 vaches inséminées après l'appel des éleveurs, seules 23 sur 74 présentes au moment du diagnostic de gestation ont effectivement été en chaleurs, parmi lesquelles 15 ont été déclarées gestantes, soit un taux de gestation de 65,2%.
1.3 Coût de l'IA
1.3.1 Coût de l'IA sur chaleurs induites
Les charges totales de l’IA ont été subdivisées en 4 postes de dépenses (Sélection, Synchronisation, insémination et DG). La structuration des dépenses de l'IA sur chaleurs induites avec un total de 3 586 697,5 F (Tableau IV), démontre la prééminence des charges liées à la synchronisation des chaleurs (Figure 7), qui représente à elle seule la moitié des coûts (50%), suivies des charges de l'IA proprement dite avec 43%, de la sélection (7%) et les frais de diagnostic de gestation (1%)..
Tableau IV: Structure des coûts de l'IA
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 5Figure 7 : Composante en pourcentage des coûts d’un service d’IA sur chaleurs induites dans la région de Kolda
1.3.2 Coût de l'IA sur chaleurs naturelles
La composition des dépenses concernant l’insémination artificielle sur chaleurs naturelles montre (Tableau IV) sans ambiguïté que 87% des charges totales reviennent à l'IA proprement dite (figure 8). Ce qui est diamétralement opposé à la charge liée à la synchronisation des chaleurs qui est nulle (0%). La sélection représente 11% des coûts ; elle est suivie par le diagnostic de gestation (2%).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 6Figure 8 : Composante en pourcentage des coûts d’un service d’IA sur chaleurs naturelles dans la région de Kolda, 2014
1.3.3 Comparaison des coûts de l'IA sur chaleurs induites et naturelles
Dans le cadre du projet, l’évaluation des coûts montre qu’en un service, le prix de revient de l’insémination d’une vache sur chaleurs induites est de 35.867 FCFA tandis qu’il est de 22.713 FCFA sur chaleurs naturelles dans la région de Kolda (Tableau V). Si nous considérons la différence des coûts constatée entre les 2 méthodes d'inséminations (sur chaleurs induites et naturelles), la réalisation d’un service d’insémination sur chaleurs naturelles permet de générer un bénéfice de 13.154 FCA, soit 37% des charges de l’insémination sur chaleurs induites. Par contre s’il s’agit d’un contrat entre prestataire et client, dans le cadre du suivi de son exploitation, le prix sera de 20305 F CFA pour l’IA sur chaleurs naturelles. Cette situation génère une économie de 15 562F CFA, soit 43,4%.du coût de l’IA sur chaleurs induites.
Tableau V: Comparaison des coûts unitaires de l’IA sur chaleurs induites et naturelles
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Discussion
2.1 Limites de l’étude
Il faut reconnaitre que la période d’expérimentation (février- juillet), bien que n’étant pas la saison des saillies, a été choisie pour mieux analyser les contraintes liées à la réalisation de ce programme, et proposer un schéma efficient pour la réalisation des IA bovines sur chaleurs naturelles. 73% des vaches ont été inséminées en dehors des périodes de chaleurs à cause des défaillances dans la communication entre éleveurs et prestataires (appels tardifs ou pour des vaches pas en chaleurs du tout). Les prestataires ont failli dans la gestion du programme en refusant de confirmer les chaleurs avant d’inséminer. Les conflits internes n’ont pas facilité le regroupement des animaux, comme indiqué dans la partie méthode, pour la gestion des chaleurs. La stabulation n’a pas été respectée comme prévu par les éleveurs. Le déficit alimentaire est la raison avancée par les éleveurs pour justifier le relâchement des animaux. La présence des taureaux et le non-respect des rendez-vous ont été constatés durant tout le long du programme. Par conséquent, l’appropriation effective du programme a fait défaut, malgré la sensibilisation.
2.2 Gestion des chaleurs
2.2.1 Détection des chaleurs
Lors de cette étude, sur 100 vaches sélectionnées pour l’IA sur chaleurs naturelles, 85 ont été vues en chaleurs dont 23 confirmées par l’inséminateur, soit un taux de détection de 27%. Hakou (2006), rapporte un taux de 61,46%. L’observation des chaleurs, selon Kouamo et al.(2009b) dépend entièrement de la vigilance et des années d’expérience de l’éleveur. Il a été de 20% et 84% respectivement pour l’éleveur sans expérience et l’expérimenté. Pour notre cas ce résultat est la conséquence d’un refus des éleveurs d’investir plus de temps à l’observation des chaleurs. Multiples sont les facteurs qui influencent l’expression des symptômes de l’œstrus. Seules les vaches cyclées et qui s’expriment auront des chaleurs détectables. La discrétion et la courte durée des œstrus (Pitala et al, 2012 ; Chanvallon et al., 2012), la température, le déficit alimentaire (Amou’ou, 2005 ; Bouyer, 2006 et Hakou, 2006), ont été cités comme des facteurs qui interfèrent considérablement sur la reproduction chez les bovins, ce qui est non négligeable en considérant notre période de recherche (saison sèche). Raison pour laquelle l’éleveur doit, en plus de l’acceptation du chevauchement, s’intéresser aussi aux signes secondaires, pour optimiser le taux de détection des chaleurs (80%).
2.2.2 Synchronisation
Dans notre étude le taux de synchronisation est de 100%. Ce chiffre est semblable à celui enregistré par Hakou (99,07%) en 2006 et supérieur aux résultats rapportés par Diop et al en 1998 (97,8%) et Kamga en 2002 (91,8%). Avec une moyenne supérieure à 90%, ces chiffres démontrent aisément que nos races locales sont sensibles aux différents protocoles d’induction et de synchronisation des chaleurs. Ce taux élevé pourrait être expliqué comme la conséquence directe du respect du protocole qui exclue toute vache non cyclée. Chicoineau, 2007 a démontré, de façon significative, que les vaches cyclées avant traitement ont de meilleurs résultats par rapport à celles qui ne l’étaient pas. La prise en compte de la cyclicité des vaches est nécessaire dans la phase de sélection, afin d’optimiser la réussite des traitements de synchronisation.
2.3 Taux de réussite de l’IA
Les taux de gestation sont de 46,25% pour l’IA sur chaleurs induites et 65,2% pour l’IA sur chaleurs naturelles. Ngono, en 2007, rapporte 40% et 42,86% à Fatick et 35,29 et 30% à Kaolack. Hakou (2006), a enregistré 37,11 et 35,12% respectivement sur chaleurs induites et naturelles. En analysant ces résultats un constat général se dégage : les résultats de l’IA sur chaleurs naturelles et induites sont similaires. Humblot en 1996, chez la race Holstein, a démontré qu’il n’y a aucune différence significative entre les taux de réussite de l’IA sur chaleurs naturelles et induites. Si nous arrivons à maitriser les facteurs de variation, il serait possible d’envisager de remplacer l’IA sur chaleurs induites par l’IA sur chaleurs naturelles qui est beaucoup plus économique. Kouamo et al, 2009a parlent de 60.68% sur chaleurs induites et 42,66% sur chaleurs naturelles en deuxième I.A. Pour des raisons d’efficience, nous avons jugé nécessaire de se limiter à un seul service. Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans la variation du taux de réussite de l’IA. L’âge, les jours post-partum et la note d’état corporel sont des facteurs qui peuvent influencer le TG (Butler, 2005 ; Hakou, 2006, Bouye r, 2006 ; Kouamo et al, 2009a). La différence des protocoles utilisés pour la synchronisation et l’induction des chaleurs justifie également, la variation des résultats entre les auteurs. Les résultats rapportés par Diadhiou en 2001 avec le Crestar 27% contre 42,7 avec le Prid en est la parfaite illustration.
2.4 Coût de l’insémination artificielle
2.4.1 Composante des coûts
2.4.1.1 coûts des intrants
La synchronisation avec 17755 F par vache a été le poste de dépenses qui a sollicité le plus d’intrants. Kouamo et al. (2009b), rapportent un coût variable de la synchronisation (6 270-6 290 FCFA) selon la nature du dispositif utilisé (Crestar- Spirale). Bouyer (2006), parle de 11 860F CFA. Ces coûts rapportés par ces derniers ne représentent que le prix des produits pharmaceutiques pour la synchronisation. Diakhoumpa (2003), annonce un coût nettement inférieur soit 10 568 FCFA. Ce dernier auteur aussi, n’a pas inclut la prestation de services. Dans notre cas, nous avons jugé nécessaire d’introduire le prix des consommables et de l’expertise dans l’évaluation finale du coût de la synchronisation. Une légère baisse du prix de la spirale de 6000 F CFA en 2009 à 5780 F CFA en 2014. Une situation identique a été observée avec l’Enzaprost qui passe de 3000 à 2700 de nos jours. Contrairement au PMSG, de 2000 à 2800F durant les mêmes années de comparaison. Les hormones (Spirale, Prostaglandine et le PMSG) représentent plus de 60% des coûts de revient de la synchronisation. Avec la généralisation de l’agriculture biologique en perspective, ces prix ne sont pas prêts à baisser. L’interdiction des œstrogènes par l’UE en octobre 2006 pour des mesures de précaution a surpris les laboratoires de recherche. Une raison de plus de privilégier l’IA sur chaleurs naturelles pour ne plus dépendre de ces intrants coûteux. Dans cette étude expérimentale, le prix de la semence sur le marché est de 8000 FCFA. Pousga (2002), parle de 3422 FCFA au Mali contre 6000 F CFA au Sénégal (Diakhoumpa, 2003). Le prix de l’azote liquide sur le marché est de 6000 F/litre. Bouyer (2006), rapporte une valeur de 4000 au Sénégal et 3000 F au Burkina Faso. Cette variation considérable du prix de la semence pourrait s’expliquer par les différentes qualités de semences existant sur le marché mais aussi l’azote liquide dont la disponibilité et le prix varient en fonction des pays et des périodes d’étude.
2.4.1.2 Charge liée au Transport
La charge liée au transport représente 4% des dépenses totales, pour l’IA sur chaleurs induites. Elle est similaire à celle rapportée par Ngono en 2007 à Fatick (3.47%). Cependant la charge de l’IA sur chaleurs naturelles est de 13,6% contre 37,47 pour Ngono, 2007 à Fatick. Cette différence de résultats entre les 2 méthodes d’IA pourrait s’expliquer par une intervention à répétition sur le terrain en fonction de la détection des chaleurs et les périodes de diagnostic de gestation. Lors des travaux réalisés par Kouamo et al. (2009a), dans le bassin arachidier, le transport représentait 31% du coût de revient de l’IA. Ces résultats prouvent que ces chercheurs ont travaillé sur de longues distances entre les élevages. Contrairement à notre cas, la zone d’étude a été circonscrite dans un rayon de 15 km par inséminateur afin de minimiser au maximum possible le coût du transport. Pour rentabiliser cette modalité d’IA, il est impératif de limiter la zone d’intervention. Sans cette condition, les économies générées par le poste de synchronisation seront entièrement reversées dans celui du transport. Cette différence aussi pourrait s’expliquer par la marque du véhicule utilisé, la période d’étude, le nombre de vaches à inséminer et la qualité des routes empruntées. L’IA, après vingt ans de pratique au Sénégal, ne doit plus être une affaire de campagne nationale, mais plutôt une activité de tous les jours selon la demande. L’inséminateur doit ainsi offrir ce service continu tant désiré par les éleveurs. Le service de l’IA de proximité pourrait être vulgarisé pour améliorer la productivité des animaux surtout dans les zones à forte production laitière.
2.4.1.3 Prestation de services
La prestation de services, durant cette étude, nous revient à 12000 FCFA repartie comme suit : 2000 FCFA pour la sélection, 5000 FCFA pour la synchronisation et 5000 FCFA pour l’acte d’IA. Ce coût est inférieur à celui rapporté par Diakhoumpa en 2003 (25 000 FCFA), dans le bassin arachidier. Kouamo et al., 2009b ont noté 10 000F CFA comme le prix moyen dans le bassin arachidier et la zone sylvo-pastorale. Ce coût couvre les frais de la synchronisation et l’acte d’IA, mais pas les frais de sélection. La démocratisation de la pratique de l’IA entrainera forcement une baisse du coût de la prestation.
2.4.2 Coût de l’IA sur chaleurs induites
Le coût unitaire représente le prix de revient de l’insémination d’une vache. Ce prix, dans le cadre du projet est de 35 867 FCFA sur chaleurs induites. Cette valeur est supérieure à celle notée par Ngono en 2007 à Kaolack (33 800F) et à Fatick (34 580F). Il est largement inférieur à ceux rapportés par Diakhoumpa, 2003 ; dont le prix de revient était de l’ordre de 48 143 FCFA par vache inséminée. Cette différence serait imputable aux variations des charges liées à la synchronisation et à la prestation de service. Dans notre cas, la synchronisation occupe à elle seule 50% de la charge totale de l’IA sur chaleurs induites. Ce qui nous pousse à dire que l’insémination sur chaleurs naturelles est une alternative pour réduire de façon significative le coût unitaire de l’IA.
2.4.3 Coût de l’IA sur chaleurs naturelles
22 713 FCFA représente le coût unitaire de l’IA sur chaleurs naturelles durant notre période d’étude. Ce chiffre est très proche de celui de Ngono en 2007 à Kaolack (21 080 F). Mais, largement inférieur aux coûts rapportés par Diakhoumpa en 2003 (48 143F) et Kalandi en 2011 (50 000F) dans le bassin arachidier. Par contre notre résultat est supérieur à ceux de Messine et al qui ont trouvé 18 300 F CFA au Cameroun en 1993. Cette large variabilité des prix serait imputable au fait que pour Kalandi (2011), ce coût représente une somme forfaitaire attribuée à l’inséminateur pour gérer même les imprévues. Pour rentabiliser cette modalité d’IA, il faudra nécessairement limiter la zone d’intervention. La pérennisation de l’IA dépend fortement du rapport qualité/prix de cette technologie.
2.4.4 Comparaison des coûts unitaires d’IA sur chaleurs induites et naturelles
Les coûts de revient sont de 35 867 pour l’IA sur chaleurs induites et 22 713 sur chaleurs naturelles. En faisant un rapport entre les deux coûts, il ressort une différence de plus de 13 154F entre les deux méthodes. Dans la littérature scientifique, malgré la clarté des orientations des résultats obtenus, il est très difficile de se pencher d’un côté du fait que chaque méthode comporte des avantages et des inconvénients. Humblot (1996) a démontré chez la race Charolaise statistiquement, qu’il n’y a aucune différence significative en termes de taux de gestation entre les deux modalités d’IA. Concernant l’IA sur chaleurs naturelles, la réussite des opérations est liée à une combinaison de l’extériorisation des signes comportementaux des chaleurs et leur détection par l’éleveur. La littérature est homogène par rapport à la notion de distribution nycthémérale des chaleurs chez les bovins (Pitala et al. 2012, chanvallon et al, 2012). Les éleveurs n’ont pas la possibilité de détecter les chaleurs la nuit, vu notre niveau d’électrification en milieu rural. Ce constat pourrait influencer les résultats de l’IA sur chaleurs naturelles. Les expressions de signes de chaleurs des bovins sont parfois insidieuses (Pitala, et al. 2012). D’après Chanvallon et al. (2012) seules 6 ovulations sur 10 sont accompagnées d’acceptation de chevauchement chez la race charolaise. La même observation a été faite sur le continent américain en parlant de la qualité de la détection des chaleurs. On estime que 15 à 30% des saillies se font alors que le niveau de progestérone sanguin est élevé, donc en présence d’un corps jaune fonctionnel (Brassard et al. 1997). Cette situation pourrait être imputable à une concentration en œstradiol suffisante pour déclencher le pic de LH donc l’ovulation mais pas assez pour l’extériorisation comportementale des signes de chaleurs. Cette détérioration de la qualité des chaleurs observées est imputable à plusieurs facteurs : la malnutrition, une déficience minérale ou vitaminique, tout facteur de stress, une sous-production d’hormone gonadotrope (brassard et al., 1997, Diop et al., 1998, Kamga, 2003). Ce phénomène nous indique que, malgré la formation des éleveurs en détection des chaleurs, la tâche n’en sera pas moins délicate et les résultats vont en souffrir. La courte durée des chaleurs chez le bovin de la zone tropicale, signalée par certains chercheurs (Pitala et al., 2012), augmentera les difficultés de l’éleveur à observer correctement les oestrus. Cette situation impliquerait une attention soutenue de la part des éleveurs dans le cadre de la détection. La prise en compte de plusieurs signes de chaleurs, autres que l’acceptation du chevauchement est une éventualité pour générer de meilleurs résultats. Parlant de l’IA sur chaleurs induites, selon Diop et al en1998, 43% des femelles N’Dama élevées en milieu traditionnel présentent des chaleurs anovulatoires, constat qui pourrait impacter fortement sur les résultats des études réalisées en milieu rural sur les deux méthodes d’IA. Les éleveurs réclament aujourd’hui, un service d’insémination de proximité. Ainsi l’exécution des programmes sous forme de campagne, c’est à dire une intervention annuelle, doit être revue car elle ne permet pas d’intégrer le maximum de vaches. Par ailleurs, elle nécessite des intrants qui coûtent chères. L’IA sur chaleurs naturelles s’avère donc être une alternative, à condition que l’éleveur consacre une heure par jour, à raison de deux observations de 30 mn, pour la détection des chaleurs. Dès lors, le coût de l’IA revient à 20305 F CFA soit un bénéfice de 15562 F CFA par vache inséminées, qui représente 43, 4% du coût unitaire de l’IA sur chaleurs induites.
Recommandations
Le Plan Sénégal Emergent (PSE), les Accords de Partenariat Economique (APE), et l’abolition du quota laitier dans l’Union Européenne (EU) depuis le 1er avril, 2015 révèlent des opportunités et des menaces pour la production locale. Pour que la courbe de l’offre se superpose avec celle de la demande, des mesures s’imposent. C’est pour cette raison que nous recommandons de privilégier l’IA sur chaleurs naturelles par rapport à l’IA sur chaleurs induites.
A l’Etat
ü La formation et/ou le recyclage des vétérinaires et agents de l’élevage du public et du privé en insémination artificielle bovine de façon permanente pour une meilleure maitrise des techniques de reproduction.
ü La vulgarisation de l’IA sur chaleurs naturelles de proximité dans les zones de forte production laitière à raison d’un inséminateur par rayon de 15 km ;
ü La mise en œuvre d’un Partenariat Publique-Privé (PPP) pour l’implantation de plusieurs usines de fabrique d’aliments de bétail à l’échelle régionale.
Aux prestataires
ü Assurer un bon encadrement et suivi des éleveurs et du troupeau ;
ü Confirmer l’apparition des chaleurs avant toute insémination ;
ü Maintenir un dialogue permanent avec les éleveurs pour leur apporter des conseils en matière de détection des chaleurs.
Aux éleveurs
ü Améliorer l’alimentation du bétail pour une meilleure expression des signes chaleurs.
ü Assurer une bonne gestion des chaleurs à travers 2 séances d’observation, matin et soir, de 30mn par jour et par séance, tout en respectant les consignes de communication une fois que les chaleurs sont observées chez au moins une vache.
Aux chercheurs
ü Accentuer la recherche sur une meilleure alimentation des bovins
ü Initier des programmes de recherche pour une optimisation de la détection des chaleurs
Conclusion
Après 20 ans de pratique au Sénégal, l’IA ne doit plus être une affaire de campagne nationale, mais plutôt une activité de tous les jours, selon la demande. La démocratisation de l’IA ne sera effective que lorsque chaque éleveur pourra bénéficier de cette biotechnologie en temps voulu et par ses propres moyens. L’étude révèle que dans le cadre du projet, le coût de l’IA sur chaleurs induites est de 35 867FCFA contre 22 715FCFA pour l’IA sur chaleurs naturelles. Cependant dans un cadre hors projet, le coût de l’IA sur chaleurs naturelles revient à 20 305FCFA soit une économie de 15 562FCFA, qui représente 43,4% du coût de l’IA sur chaleurs induites. Economiquement, l’IA sur chaleurs naturelles est meilleure, à condition que la zone d’intervention de chaque inséminateur soit circonscrite dans un rayon de 15 km. Il faudra impérativement aussi que l’éleveur accepte d’investir plus de temps dans le cadre de la détection des chaleurs. L’extériorisation, la détection et la qualité des chaleurs sont des défis énormes pour la réussite des programmes de cette nature. L’éleveur est le point focal pour la réussite de son élevage. Sa capacité à observer les chaleurs est déterminante pour l’adoption définitive de l’IA sur chaleurs naturelles. L’alimentation est une piste à explorer pour optimiser l’expression et la détectabilité des chaleurs de qualité. Il est nécessaire de reprendre la même étude en saison humide pour pouvoir établir un schéma de vulgarisation de l’IA sur chaleurs naturelles. Ce travail pourrait être, également, amélioré en introduisant dans la méthodologie des outils d’aide à la détection des chaleurs, notamment l’utilisation de dispositifs révélateurs de chevauchement. L’utilisation des taureaux vasectomisés est souvent plébiscitée dans la littérature scientifique.
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
1. AMOU’OU B.S., 2005. Etude des facteurs de variation du taux de réussite en première insémination artificielle dans le bassin arachidier (Sénégal). Mémoire : production animale : Dakar (EISMV) ; 1.
2. BA S., 2013. Evaluation de l’efficacité de la campagne d’insémination artificielle 2010-2011 réalisée par PDESOC dans la région de Tambacounda. Thèse : Med. Vet : EISMV-Dakar, 151p.
3. BOUYER B., 2006. Bilan et analyse de l’utilisation de l’insémination artificielle dans les programmes d’amélioration génétique des races laitières en Afrique soudano-sahélienne. Thèse : Méd. Vét. : Lyon; 04.
4. BRASSARD P., MARTINEAU R., et TWAGIRAMUNGU H., 1997. L’insémination à temps fixe : enfin possible. Symposium des bovins laitiers. CPAQ- p78.
5. BUTLER W.R., 2005. Relationships of negative energy balance with fertility. Adv. Dairy Tech., 17, pp35-46.
6. CHANVALLON A., GATIEN J., SALVETTI P., BLANC F., PONSART C., FRAPPA B. et al., 2012. Améliorer la détection des chaleurs dans les troupeaux bovins. Inno. Agro. 25 : pp283-297.
7. CHICOINEAU V., 2007. Comparaison de l’efficacité du traitement de synchronisation des chaleurs CRESTAR classique avec celle du nouveau traitement CRESTAR SO chez la vache laitière. Thèse Med. Vet. Alfort.75p.
8. DIA D., 2010. Dossier d’information complet du Colloque « Culture des laits du monde » Paris les 6 et 7mai. [En ligne] accès internet (page consultée le 25/04/2016) :
[http://www.lemangeur-ocha.com/wp content/uploads/2012/04/Laits-du-monde-S4-DD2.pdf)]
9. DIADHIOU A., 2001. Etude comparative de deux moyens de maîtrise de la reproduction (L’implant CRESTAR® et la Spirale PRID®) chez les vaches N’Dama et Gobra au Sénégal. Thèse : Méd.Vét. Dakar : EISMV, Dakar, 84p.
10. DIAPHOUMPA M. , 2003 Analyse coût / bénéfice de l’insémination bovine au Sénégal. Mémoire de DEA : Productions Animale : Dakar (EISMV) 38p.
11. DIOP P.E.H., FAYE L., FALL R., LY O., SOW A.M., MBAYE M., FALL A., FAYE A. et BOYE C., 1998. Caractéristiques de l'oestrus chez les femelles N'Dama et jersiaises au Sénégal après maîtrise du cycle sexuel au Norgestomet. Rev. Elev. Med. Vet. Pays Trop., 51(1) : 69-73.
12. HAKOU T.G.L., 2006. Insémination artificielle bovine basée sur la détection des chaleurs naturelles par les éleveurs dans les régions de Fatick, Kaolack et Louga. -Thèse : Méd. Vét. : Dakar ; 29
13. HANZEN C., 2015-2016. La détection de l’oestrus chez les ruminants. [En ligne] accès internet (page consultée le 1/05/2016) :
[https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/70540/1/R04_Detection_oestrus_2016.pdf]
14. HANZEN C., THERON L., et RAO A-S., 2013. Gestion de la reproduction dans les troupeaux bovins laitiers. RASPA, 11 (5) : 91-105.
15. HERRERO M., HAVLIK P., MCINTIRE, J., PALAZZO, A. et VALIN H., 2014. L’avenir de l’élevage africain : Réaliser le potentiel de l’élevage pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement en Afrique sub-saharienne. UNSIC, Genève, Suisse, 118 p.
16. HUMBLOT P., GRIMARD B., PONSART C., FRANCK C., KHIREDINE et BJEANGYOT N., 1996. Résultats de reproduction après IA sur chaleurs naturelles ou après synchronisation de l’oestrus chez la vache charolaise. Rench. Rech. Ruminants 3, 195.
17. KALANDI M., 2011. Evaluation financière de l’insémination artificielle sur chaleurs naturelles dans les petits élevages traditionnels de la région de Kaolack au Sénégal. Mem. EPE. EISMV-Dakar. N°17-32p.
18. KAMGA-WALADJO A.R., 2003. Performance zootechnique des N’Dama et des produits issus de l’insémination artificielle bovine en République de Guinée-Mémoire DEA : Productions animales : Dakar (EISMV) ; 12.
19. KAMGA-WALADJO A.R., 2002. Réalisation d’un programme d’insémination artificielle bovine en République de Guinée. Thèse vétérinaire, Dakar, N°13,101p
20. KOUAMO J., SOW A., LEYE A., MBACKE DIONE., SAWADOGO G.J., et OUEDRAGO G.A., 2009a. Etude comparative de deux stratégies d’insémination artificielle, basées sur les chaleurs naturelles et chaleurs synchronisées des vaches locales et métisses en milieu traditionnel au Sénégal. RASPA, 7 (2) : 89-95.
21. KOUAMO J., SOW A., LEYE A., SAWADOGO G.J. et OUEDRAGO G.A., 2009b Amélioration des performances de production et de reproduction des bovins par l’utilisation de l’insémination artificielle en Afrique Sub-saharienne et au Sénégal en particulier : état des lieux et perspectives RASPA, 7 (3-4) : 139-148.
22. MESSINE O., MBAH D.A. et SAINT-MARTIN G., 1993. Synchronisation de l’oestrus chez les femelles zébus Goudali au CRZ de Wakwa (Cameroun). pp13-19. In : « Maitrise de la reproduction et amélioration génétique des ruminants : Apport de nouvelles technologies » Dakar : A.U.P.E.L.F, UREF: NEAS. – 290p.
23. NGONO E.P.J., 2007. Evaluation de l’impact potentiel et de l’acceptabilité des stratégies d’insémination artificielle bovine plus efficientes basées sur les chaleurs naturelles et induites dans le bassin arachidier : cas des régions de Kaolack et Fatick . DEA. Production Animale: EISMV-Dakar, N°4-32p.
24. PITALA W., ZONGO M., BOLY H., SAWADOGO L., LEROY P., BECKERS J. F. et GBEASSOR M., 2012. Etude de l’oestrus et de la fertilité après un traitement de maitrise des cycles chez les femelles zébus. Int. J. Biol. Chem. Sci. 6 (1) : 257-263.
25. POUSGA S., 2002. Analyse des résultats de l’insémination artificielle bovine dans des projets d’élevages laitiers : exemple du Burkina Faso, du mali et du Sénégal. Thèse de Doctorat vétérinaire, EISMV, Dakar, 82 p.
26. SAWADOGO G.J., 1998. Contribution à l’étude des conséquences nutritionnelles sub-sahéliennes sur la biologie du Zébu Gobra au Sénégal. Thèse Doctorat Institut National Polytechnique, Toulouse ; 213p.
27. SENEGAL. Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 2013. Situation Economique et Sociale de la région de Kolda.
28. SENEGAL. Ministère de l’Elevage et de la Production Animale (MEPA), 2013. Rapport d’activité. 35p.
29. SENEGAL. Ministère de l’Elevage, 2004. Nouvelles initiative sectorielle pour le développement de l’élevage « NISDEL », Dakar, Sénégal, DIREL, 42 p.
30. VALL E. et BAYALA I., 2004. Note d’état corporel des zébus soudanais. In: Production animale en Afrique de l’Ouest; fiche technique N° 12, 8p.
ANNEXE
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
DETERMINATION DU COUT DE L’INSEMINATION ARTIFICIELLE SUR CHALEURS NATURELLES ET INDUITES DANS LA REGION DE KOLDA, ZONE D’INTERVENTION DU PDESOC.
Résumé
La démocratisation de l’insémination artificielle (IA) ne sera effective que lorsque chaque éleveur aura accès à cette technologie en temps voulu et par ses propres moyens. L’IA sur chaleurs induites reste la modalité la plus plébiscitée au Sénégal. Après vingt ans de pratique, la vulgarisation de cette biotechnologie pose toujours problème, compte tenu de son coût qui est hors de portée des éleveurs . L’IA sur chaleurs naturelles s’avère une alternative pour la démocratisation de l’IA au Sénégal. Pour atteindre cet objectif, le PDESOC a mis en œuvre un protocole pour la comparaison des coûts de l’IA sur chaleurs naturelles et induites, dans la région de Kolda. L’étude a révélé, que le coût de revient d’un service d’IA sur chaleurs induites est de 35 867FCFA contre 22 715FCFA pour l’IA sur chaleurs naturelles, soit une réduction de 13 154FCFA. Dans le cadre du suivi de son exploitation, un éleveur peut réduire ce coût à 20 305FCFA, en investissant seulement, plus de temps dans la détection des chaleurs. Le respect de cette recommandation permet de générer une économie de 15 562FCFA à l’éleveur, soit 43,4% du coût de l’IA sur chaleurs induites. Economiquement, l’IA sur chaleurs naturelles est meilleure, à condition que la zone d’intervention de l’inséminateur soit circonscrite dans un rayon de 15 km dans une zone à forte production laitière. L’éleveur est, dans ce cas précis, le point focal de la réussite de son élevage. Sa capacité à observer les chaleurs est déterminante pour l’adoption définitive de cette modalité d’IA.
Abstract
The democratization of Artificial insemination (AI) will be effective only when each farmer will have access to this timely technology and with its own means. The AI on heat induced remains the most common AI in Senegal. After twenty years of practice, the extension of this biotechnology is still a problem, given that its cost is beyond the reach of farmers. The AI on natural heat turns is alternative for the democratization of AI Senegal. To achieve this goal, the PDESOC implemented a protocol for comparing the cost of AI on natural and induced heat in the Kolda region. In the project, studie have shown that the AI on induced heat costs 35 867F CFA compared to 22 715F CFA for the AI on natural heats, a difference of 13 154FCFA. In and out of the context of the project, a breeder can reduce the cost of AI over natural heat to 20 305F CFA, by only investing more time in heat detection. Compliance with this recommendation generates a profit of 15562F CFA to the breeder, which represents 43, 4% of the cost of AI on induced heat. Economically, IA on natural heat is better, if the inseminator's intervention area is circumscribed within a radius of 15 km. The breeder is the focal point of his successful breeding. His ability to observe the heats is decisive for the final adoption of this modality IA
Mots clés: Cost of artificial insemination, Induced heat, Naturel heat, PDESOC, Kolda.
Questions fréquemment posées
Quel est le sujet principal du document?
Le document compare les coûts de l'insémination artificielle bovine sur chaleurs naturelles et induites au Sénégal, en mettant l'accent sur la région de Kolda.
Quels sont les principaux objectifs de l'étude?
Les objectifs spécifiques sont de renforcer la capacité des éleveurs en termes de détection de chaleurs, comparer les résultats des IA sur chaleurs induites et naturelles, déterminer le coût unitaire de l’IA sur chaleurs induites et naturelles, comparer les coûts des IA sur chaleurs induites et naturelles ainsi que les contraintes.
Quelles sont les principales races bovines exploitées au Sénégal selon le document?
Les principales races sont N'Dama, Zébu Gobra, et les races exotiques comme Holstein, Montbéliarde, et Jersiaise.
Quelles sont les principales contraintes de l'élevage bovin au Sénégal mentionnées?
Les contraintes majeures incluent le climat, la génétique, la faiblesse de la couverture sanitaire contre les maladies endémiques, et la concurrence de la poudre de lait importée.
Qu'est-ce que l'insémination artificielle (IA)?
L’insémination artificielle est un outil biotechnologique de la reproduction de première génération, qui consiste à féconder une femelle en déposant, au moment des chaleurs, la semence collectée et conditionnée, issue de l’appareil génital mâle; dans la partie la mieux indiquée des voies génitales femelles à l’aide d’un pistolet inséminateur.
Quelles sont les deux modalités d'IA mentionnées et en quoi diffèrent-elles?
Les deux modalités sont l'IA sur chaleurs naturelles et l'IA sur chaleurs induites. L'IA sur chaleurs naturelles repose sur la détection des chaleurs par l'éleveur, tandis que l'IA sur chaleurs induites utilise des hormones pour synchroniser et induire les chaleurs.
Quels sont les principaux résultats de l'étude concernant les coûts?
L'étude a révélé que le coût d'un service d'IA sur chaleurs induites est de 35 867 FCFA contre 22 715 FCFA pour l'IA sur chaleurs naturelles. Dans un cadre hors projet, le coût de l'IA sur chaleurs naturelles revient à 20 305FCFA.
Quel est le rôle du PDESOC dans le contexte de l'étude?
Le PDESOC (Programme de Développement de l’Elevage au Sénégal Oriental et en haute Casamance) a mis en œuvre un protocole d’insémination artificielle bovine sur chaleurs induites et naturelles dans la région de Kolda, dans le but de comparer les coûts et d'améliorer la productivité de l'élevage.
Quelles sont les recommandations formulées à la suite de l'étude?
Les recommandations incluent de privilégier l’IA sur chaleurs naturelles par rapport à l’IA sur chaleurs induites, former les acteurs de l’élevage, et vulgariser l’IA sur chaleurs naturelles de proximité dans les zones de forte production laitière.
Quels sont les facteurs qui influencent le taux de réussite de l'IA?
L'âge, l'état corporel de l'animal, la période post-partum, l'état sanitaire, l'alimentation, la température et la qualité des chaleurs détectées sont des facteurs importants.
- Citation du texte
- Mamadou Alpha Ghadiry Diallo (Auteur), 2016, Détermination du cout de l'insémination artificielle sur chaleurs naturelles et induites dans la région de Kolda, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435013