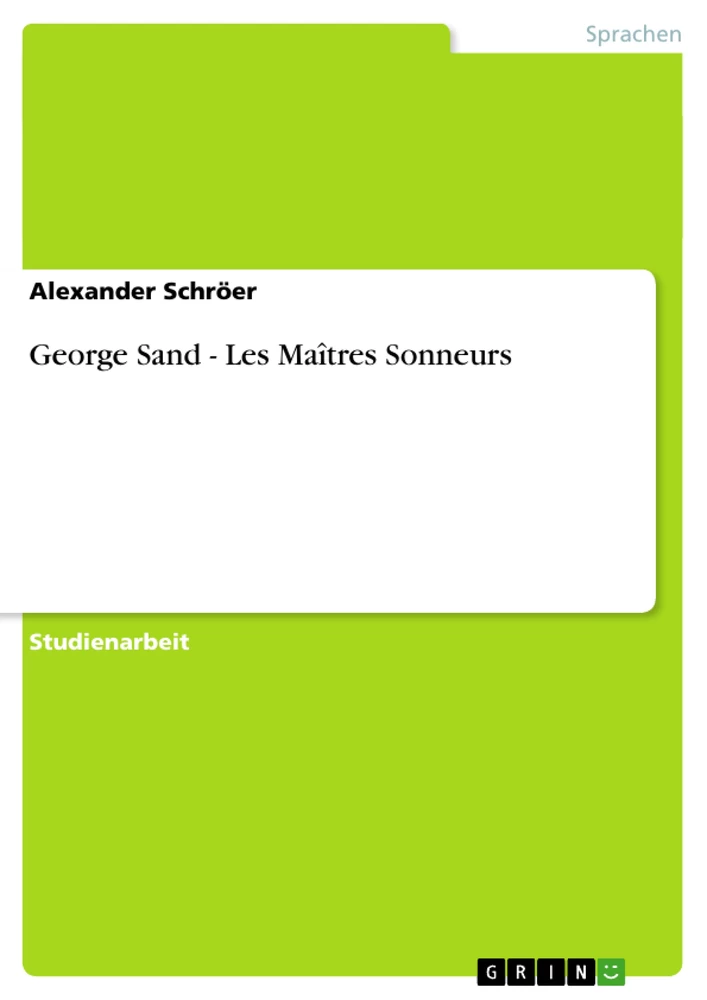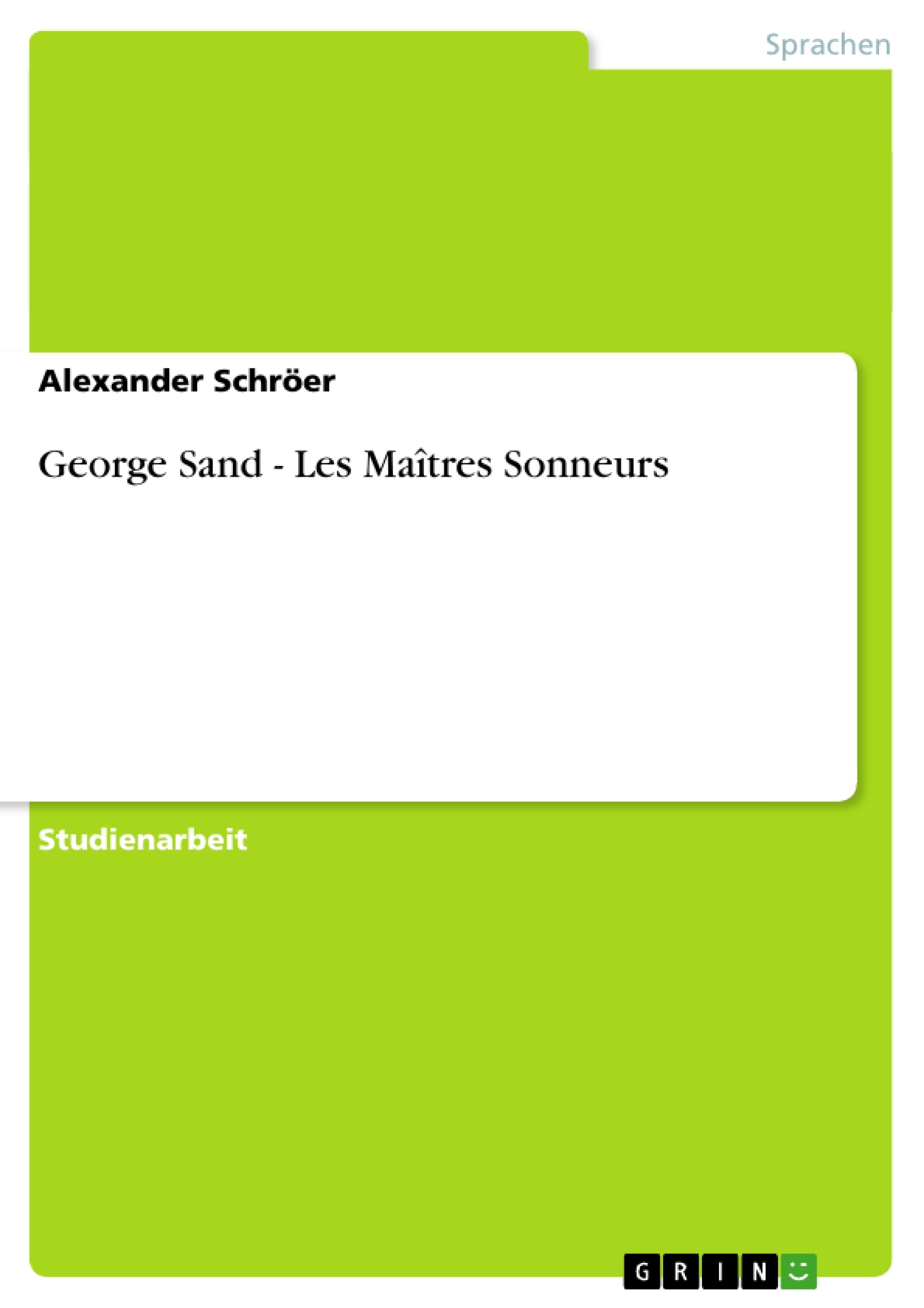Ein Echo aus dem Herzen Frankreichs, wo die sanften Hügel des Berry auf die wildromantische Landschaft des Bourbonnais treffen, erklingt in George Sands vergessenem Meisterwerk "Die Meisterpfeifer". Doch warum ist dieser Roman, der so reich an Mysterien, Symbolik und Initiationsriten ist, in Vergessenheit geraten? Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Traditionen der Dudelsackpfeifer lebendig sind, die Eigenheiten der Landbevölkerung im Einklang mit der Natur stehen und junge Menschen ihren Weg ins Leben suchen – eine Welt, in der Erfolg und Tod, Liebe und Musik untrennbar miteinander verwoben sind. Sand entführt uns ins Berry des 19. Jahrhunderts, wo der alte Tiennet seine Lebensgeschichte in 32 stimmungsvollen "Veillées" (Nachtwachen) erzählt. Wir begegnen dem jungen, talentierten Joseph, dessen Leidenschaft für die Musik ihn in Konflikt mit den Traditionen und Erwartungen seiner Gemeinschaft bringt. Die Begegnung mit dem geheimnisvollen Huriel, einem Meisterpfeifer aus dem Bourbonnais, verändert Josephs Leben für immer. Die Musik wird zur alles bestimmenden Kraft, die Freundschaften schmiedet, Rivalitäten entfacht und letztendlich über Leben und Tod entscheidet. "Die Meisterpfeifer" ist jedoch mehr als nur eine Geschichte über Musik und Freundschaft. Es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Gegensätzen zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen ländlicher Idylle und dem Streben nach künstlerischer Verwirklichung. Sand verwebt geschickt regionale Eigenheiten, Dialekt und die Mystik alter Bräuche zu einem fesselnden Roman, der den Leser in eine vergangene Welt entführt. Die Gegenüberstellung von Berry und Bourbonnais, von Klarheit und Dunkelheit, spiegelt sich in der Musik wider und kulminiert in einem dramatischen Finale, das die Gefahren des unkontrollierten Ehrgeizes und die zerstörerische Kraft der Leidenschaft offenbart. Entdecken Sie ein vergessenes Juwel der französischen Literatur, eine Hommage an die ländliche Kultur und eine zeitlose Erzählung über die Macht der Musik und die Suche nach dem eigenen Weg. Lassen Sie sich von Sands poetischer Sprache und den vielschichtigen Charakteren verzaubern und erleben Sie ein Stück Frankreich, das in seiner Ursprünglichkeit und Schönheit unvergessen bleibt. "Die Meisterpfeifer" ist eine Reise in die Vergangenheit, die uns gleichzeitig viel über die Gegenwart lehrt. Es ist ein Roman für alle, die sich nach Authentizität, Leidenschaft und der tiefen Verbindung zur Natur sehnen, ein Fest für Liebhaber französischer Literatur, Folklore und die Magie der Musik, eine Geschichte über die Suche nach Identität, die Kraft der Gemeinschaft und die bittersüße Melodie des Lebens im Berry des 19. Jahrhunderts, ein Spiegelbild der menschlichen Seele und die ewige Sehnsucht nach Harmonie.
TABLE DES MATIERES
1. Introduction
2
2.1 La structure
2.2 Le style et le langage
2.3 L'élément régional
2.4 La musique
3. Résumé
4. Bibliographie
Chapitre 1 Introduction
Le Berry et les Berrichons, les mystères de la musique et de l'amour - ce sont des termes qui caractérisent à la fois la vie de George Sand et celle des "Maîtres Sonneurs". On peut se demander pourquoi ce roman est un peu oublié bien qu'on y trouve tant de mystère, de symbolisme voire même tant de rites initiatiques: les coutumes des cornemuseurs, le caractère des habitants de ces contrées mis en parallèle avec le paysage, les jeunes gens qui trouvent leur place et font leur trou dans la vie, l'échec et la mort de Joseph etc... C'est donc un roman à mille facettes que nous tenterons d'analyser.
Malheureusement, les esprits littéraires, eux aussi, ont un peu oublié ce roman; la plupart des articles datent donc des années cinquante1. On s'intéresse alors surtout à la genèse et à la structure2 ou à l'élément régionaliste et folklorique3. En outre, il existe des travaux concernant l'influence du dialecte berrichon sur le langage littéraire de George Sand4. Dans plusieurs de ces travaux, les auteurs ont aussi traité les questions à savoir telles la perception et la fonction de la musique dans ce roman5. La préface de Marie- Claire Bancquart fourmille d'informations et cette édition est l'une des plus récentes6.
George Sand écrivit ce roman dans la troisième période de sa vie. Après l'échec des mouvements démocrates et réformateurs de 1848, George Sand s'était retirée en province, dans son Berry. C'est là, dans son château de Nohant, le 2 janvier 1853, qu'elle commence à rédiger "Les Maîtres Sonneurs"7. Au début, elle projette d'écrire un roman dont le titre serait "La mère et l'enfant". Par là, elle manifestait l'intention de mettre l'accent sur le mystère du petit Charlot et sur les problèmes qui en résultaient pour Brulette. Un mois plus tard, elle songe à intituler son roman "Les Maîtres Sonneurs", qui sera terminé le 26 février. Pour un roman d'une telle ampleur, George Sand écrivit rapidement8. La correction dura jusqu'au 1er avril et fut interrompue par un séjour de deux semaines de son auteur à Paris. L'oeuvre fut finalement publiée dans Le Constitutionnel, du 1er juin au 16 juillet 1853, en trente-deux feuilletons. Elle parut aussi en librairie chez Cadot à Paris et chez Lebègue à Bruxelles en 1853.
Si on veut analyser le roman, il faut avoir à l'esprit les différents éléments du récit dont j'ai déjà parlé. Après une analyse de la structure et du style, je vais donc aborder le rôle des éléments régionaux et surtout ceux de la musique et de l'artiste.
Chapitre 2
2.1 La structure
En lisant attentivement le roman, on découvre très vite la simplicité et la clarté de l'organisation du récit. Il existe une sorte de cadre, mais ni retours en arrière ni vues dans l'avenir. George Sand évoque l'image d'un grand-père, le vieux Tiennet, qu'on appelle maintenant Etienne, qui raconte son histoire pendant trente deux veillées. C'est aussi pourquoi les chapitres sont intitulés 'veillées'. Cela correspond aussi "aux nécessités de la publication dans Le Constitutionnel, chaque veillée formant en général la matière d'un feuilleton"9. Mais déjà à la deuxième page, l'action commence. La première veillée présente les personnages au lecteur, elle remplit donc la fonction classique du prologue. L'action peut être divisée en cinq épisodes:
1. 2ème - 6ème veillée:
2. 7ème - 10ème veillée:
3. 11ème - 18ème veillée:
4. 19ème - 28ème veillée:
5. 29ème - 32ème veillée:
La vie des jeunes gens dans le Berry et la première apparition d'Huriel
La fête de la St. Jean et le départ de Joseph dans le Bourbonnais pour apprendre la musique Le voyage de Tiennet et de Brulette dans le Bourbonnais pour aller chercher Joseph L'apparition de Charlot et la noce au Chassin L'assemblée mystérieuse des sonneurs On peut considérer la fin de la trente-deuxième veillée comme épilogue: la céremonie des trois noces se déroule et le grand bûcheux rentre une dernière fois pour annoncer la mort de Joseph et pour mettre en garde le public contre les dangers fatals de la musique10.
Si on désire étudier la structure du roman d'une façon plus approfondie, il faut admettre que ce dernier ne peut pas être trop travaillé à cause de la vitesse d'écriture de George Sand, qui écrivit l'oeuvre en moins de deux mois. Comme nous l'avons déjà vu plus haut, le début et la fin du roman représentent des ‘états statiques’. A la fin, on retrouve des passages qui reprennent des situations du début, p.ex. Joseph dit à Tiennet après l'avoir sauvé des cornemuseurs jaloux dans la cave du château:
Eh bien, mon Tiennet, nous voilà comme autrefois, quand, au retour du catéchisme, nous nous reposions dans un fossé, après nous être battus avec les gars de Verneuil? Comme dans ce temps-là, tu m'as défendu à ton dommage...11
Le passage correspondant du début est le suivant:
... dans mon jeune temps, nous disons: J'ai été au catéchisme avec un tel, c'est mon camarade de communion. C'est de là que commencent les grandes amitiés de jeunesse...12
Les thèmes de la jalousie13 et de la relation entre Tiennet et Thérence sont également deux autres éléments qui se correspondent au début et à la fin du roman. Les deux personnages se rencontrent au bord de la route comme enfants14 et après quelques aventures et s'être perdus de vue, ils finissent par se marier15. Lors de la rédaction finale, George Sand a probablement ajouté l'épisode de la rencontre entre Tiennet et Thérence pour créer du suspense16. De ce fait, nous pouvons également remarquer qu'il y a des transformations entre le premier état statique et le deuxième état statique. C'est aussi Brulette qui subit des transformations17: Au début, elle "ne sortait guère par les mauvais temps, avait soin de s'ombrager du soleil"18 comme une demoiselle berrichonne, mais à la fin elle se comporte comme son mari Huriel, le Bourbonnais19.
La musique provoque aussi des transformations chez les personnages: après l'avoir découverte, Joseph change et le premier ensemble statique commence donc à se déstabiliser. La décision du grand bûcheux de s'installer au Chassin marque l'accomplissement du deuxième état statique, à savoir le grand musicien se fixe pour vivre en famille et abandonne la musique, alors que Joseph est tué par la musique.
Finalement, les deux contrastes, la vie berrichonne et la vie bourbonnaise sont conciliées et métaphoriquement représentées par les trois noces, tout le monde vit d'une façon fort heureuse. On pourrait penser que c'est une structure un peu simpliste, mais le récit est, sans conteste, cohérent, et cette cohérence est celle de l'écriture elle-même. George Sand formula une conclusion exacte: "... les oeuvres réussies le sont par l'inspiration et [...] la composition tue et refroidit tout"20.
2.2 Le langage et le style
Le problème qui se pose à George Sand dans tous les romans champêtres, c'est de savoir jusqu'à quel point elle peut se servir du langage et du style des paysans berrichons. D'une part, il ne faut pas perdre l'authenticité, mais d'autre part, George Sand veut écrire de la littérature et celle-ci impose des règles et veut être comprise dans toute la France.
Quelle solution George Sand a-t-elle donc trouvée? Elle choisit des termes du patois berrichon21 ou ceux qui ont un petit air régional, mais seulement avec modération:
Forcée de choisir dans les termes usités de chez nous, ceux qui peuvent être entendus de tout le monde, je me prive volontairement des plus originaux et des plus expressifs; mais, au moins, j'essayerai de n'en point introduire qui eussent été inconnus au paysan que je fais parler ...22
Dans les deux études très détaillées sur la langue de George Sand23, on peut relever qu'elle évitait souvent d'utiliser le vrai patois berrichon24 et lui substituait parfois des termes de l'ancien et du moyen français ce qui donnait à son lecteur l'impression de vivre dans le monde paysan puisque les archaïsmes étaient plus nombreux dans les patois, vu leur caractère conservateur, que dans le français standard.
Ainsi, on trouve bon nombre de mots et de tournures en patois et j'en cite quelques uns ci-après: plusieurs fois, on trouve la chute du r final (p.ex. bûcheux au lieu de bûcheur, cornemuseux au lieu de cornemuseur) et des mots de patois (p.ex. se tourer = se battre - p. 138 - ou courza = houx - p. 259). En outre, George Sand invente des mots (p.ex. "mon père disait que Brulette aimait trop la bienaiseté" - p.82 ou "... depuis qu'il a inventé ce fluteriot" - p. 110), défigure des locutions courantes pour leur donner un petit air paysan et emploie des mots anciens, soit qu'ils étaient connus dans le Berry (p.ex. l'accoutumance = l'habitude - p. 71) soit qu'ils ne l'étaient pas du tout (p.ex le lignage = ensemble des personnes appartenant à la même lignée - p. 61)25.
Le style se caractérise aussi par des irrégularités grammaticales et syntaxiques. La syntaxe est parfois un peu lourde, George Sand multiplie les propositions subordonées et explicatives etc.26. Puisqu'un paysan ne peut pas s'exprimer d'une façon recherchée, George Sand fait des fautes voulues pour reconstituer une atmosphère paysanne.
Pour conclure, je dirais que l'atmosphère champêtre de ce roman est rendue par le vocabulaire. On ne peut pas dénommer ‘paysannes’ les constructions stylistiques lourdes. "Les mots y sont quelquefois, me disait une jeune paysanne lettrée de la Loeuf, en me parlant des Maîtres Sonneurs, mais ce n'est pas comme ça qu'on parle ici"27. Les Maîtres Sonneurs font partie de la littérature française et non de la littérature berrichonne.
2.3 L'élément régional
Mis à part les protagonistes réels, il existe deux autres figures centrales du roman, à savoir le Bourbonnais et le Berry; le pays où George Sans est née, où elle vit de tout son coeur, et où elle rentre après les échecs de ses tentatives et espoirs révolutionnaires. Toutes les indications topographiques sont réelles, on pourrait se promener dans ce pays en se servant de ce roman comme guide si les changements et les constructions de routes et de barrages n'avaient fait disparaître beaucoup de forêts au cours des siècles28.
George Sand employa même une vieille carte du dix-huitième siècle pour pouvoir décrire les lieux tels qu'ils étaient au moment où se déroule l'action.
Le récit s'articule autour de ‘veillées’ et non de chapitres, ce qui renforce le côté régional de la structure du roman. Les personnages sont bien enracinés dans la vie du pays29 et l'action est certes fictive, mais elle aurait pu se passer telle quelle dans la réalité. En outre, les éléments mystérieux et presque fantastiques30, comme les promenades nocturnes de Joseph et l'apparition des mulets au début ou la cérémonie démoniaque des sonneurs dans les caves du château, sont indispensables pour exprimer la superstition des paysans.
Bien sûr, le roman est non seulement le miroir des coutumes et des aventures paysannes, mais encore celui des symboles et des idées de George Sand. Tiennet est le paysan berrichon, gai, réaliste, honnête, fier de son travail. Mais en comparaison avec Huriel, Thérence et le grand bûcheux, c'est-à-dire les Bourbonnais, les Berrichons paraissent un peu pâles, lents et braves31. Les Bourbonnais sont des hommes plus séduisants, plus vifs, plus artistes auréolés de tout le prestige de l'aventure et du mystère, mais aussi rudes et archaïques32. Cette opposition33 se trouve aussi dans la description de la nature. Quand Tiennet et Brulette quittent leur plaine pour se rendre dans le Bourbonnais montagneux, ils ont l'impression d'une nature plus sauvage et même menaçante:
Le pays me [Tiennet] paraissait de plus en plus vilain. C'était toutes petites côtes vertes coupassées de ruisseaux bordés de beaucoup d'herbes et de fleurs qui sentaient bon, mais ne pouvaient en rien amender le fourrage. Les arbres étaient beaux et le muletier prétendait ce pays plus riche et plus joli que le nôtre, à cause des ses pâturages et de ses fruits; mais je n'y voyais pas de grandes moissons, et j'eusse souhaité être chez nous...34
Au fil des aventures, les Berrichons et les Bourbonnais se rapprochent. A la fin, les personnages réconcilient les deux modes de vie, Brulette et Tiennet veulent adopter la manière bourbonnaise ("Tiennet, me disait-elle [Brulette] souvent, il faudra, je le vois, que le Berry soit vaincu en nous par le Bourbonnais"35 ) et le grand bûcheux décide que les deux familles, nouées par les mariages de Brulette avec Huriel et de Thérence avec Tiennet, se fixent - ce qui est typique pour un Berrichon - au Chassin, une région située entre les deux provinces et qui ressemble un peu aux deux.
C'est alors qu'on découvre la valeur symbolique de ce paradis paysan. George Sand était rentrée de la grande ville, déçue par les échecs de la révolution, et continuait à rechercher une utopie sociale, caractérisée par l'harmonie et le bonheur. C'est justement dans ce monde paysan qu'elle croit avoir trouvé cette idée romantique.
Il existe encore un autre indice pour appuyer cette thèse: tous les protagonistes - sauf Joseph, mais sa fonction n'a rien à voir avec le complexe régionaliste - sont décrits très favorablement, ce sont tous des gens sympathiques, même idéalisés. Le régionalisme est donc fortement lié au le romantisme et à un but didactique:
Wir müssen uns eben mit der Tatsache abfinden, daß bei der Schöpfung der edlen und erhabenen Bauerngestalten eine bewußte Tendenz vorliegt, nämlich den Großstadtmenschen ein Ideal vorzuzaubern und sie zum Nachleben aufzufordern.36
D'une part, on sent l'amour de George Sand pour son pays d'enfance, elle fait dialoguer "la plaine et la montagne, les champs et les forêts, le Berry et le Bourbonnais"37. Elle fait le portrait des gens avec leurs coutumes, leurs aventures et leur bonheur. Mais les Maîtres Sonneurs sont plus qu'un hymne à la gloire du Berry et du Bourbonnais et les accents régionalistes ont des fonctions importantes pour l'intention didactique de George Sand.
2.4 La musique
Jusque là, on pourrait considérer les Maîtres Sonneurs comme le roman des aventures de jeunes paysans berrichons. Mais c'est la musique qui rend de la force et de la magie au roman ce qui est necessaire pour que l'action commence: sans elle, Joseph n'aurait pas quitté sa vie de bouaron berrichon; sans elle, Tiennet et Brulette ne se seraient jamais rendus dans le Bourbonnais et les deux familles ne se seraient pas fréquentées et unies et enfin, sans la musique, George Sand n'aurait pas pu montrer la réconciliation entre le Berry et le Bourbonnais. Mais à part sa fonction et sa nécessité pour l'action du roman, il nous faut à présent analyser comment George Sand expose la musique et le rôle de l'artiste38.
Logiquement, la musique est ici la musique des paysans, pas trop élaborée et au sens artistique du terme. George Sand fête l'idéal du paysan artiste qui fait de la musique avec son âme et son coeur. La technique a moins d'importance. Mais cela ne signifie pas que la musique savante39 soit plus riche, les sonneurs en ont simplement une autre conception:
Le grand bûcheux [...] poursuivit ainsi son discours: La musique a deux modes que les savants, comme j'ai ouÎ dire, appellent majeur et mineur, et que j'appelle, moi, mode clair et mode trouble; ou, si tu veux, mode de ciel bleu et mode de ciel gris; ou encore mode de la force ou de la joie, et mode de la tristesse ou de la songerie [...] car tout, sur la terre, est ombre ou lumière, repos ou action.40
La nature est donc à la source des principales caractéristiques de la musique et inspire les musiciens qui, eux alors, agissent par génie, instinct et intuition. De nouveau, George Sand évoque la différence entre le Berry et le Bourbonnais41. Le grand bûcheux dit à Joseph:
La plaine [le Berry] chante en majeur et la montagne [le Bourbonnais] en mineur. Si tu étais resté en ton pays, tu aurais toujours eu des idées dans le mode clair et tranquille [...] si tu veux connaître le mineur, va le chercher dans les endroits tristes et sauvages, et sache qu'il faut quelquefois verser plus d'une larme avant de se bien servir d'un mode qui a été donné à l'homme pour se plaindre de ses peines, u tout au moins pour soupirer ses amours.42
On peut voir ici une idée bien connue chez George Sand, à savoir le cheminement difficile à la maîtrise de la musique et, par conséquent, l'art doit être difficile et douloureux. Il faut du travail et de la maîtrise de soi-même, et pas seulement du génie et de l'intuition. Parmi les Berrichons, seul Joseph en possède43, mais son enthousiasme et sa fascination pour la musique finissent par le tuer. Le grand bûcheux, qui incarne l'équilibre entre les deux extrêmes, rapporte: "Il n'a pu échapper à son étoile. Je pensais avoir adouci son orgueil, mais, [...] il devenait chaque jour plus hautain et plus farouche"44. Joseph est plus qu'un personnage du roman, il est le symbole du musicien romantique, le symbole même de l'artiste romantique. Si l'on adopte une perspective psychanalytique, on découvre clairement la mise à mort du type de l'artiste romantique que George Sand avait si souvent aimé et dont elle avait tant souffert: Chopin, Musset,...
George Sand attribue aussi au monde de la musique un aspect mystérieux et de société secrète. Quand Joseph fait de la musique, il semble être dans un autre monde. En outre, surtout au début, la musique inconnue d'Huriel crée des associations d'images presque fantastiques sur le lecteur45. Tout cela atteint son apogée vers la fin lorsque Joseph participe aux rites dangereux dans les caves du château46. La société secrète des maîtres sonneurs - des gens qui vivent volontairement à l'extérieur de la société - est jalouse du savoir et du génie de Joseph et on veut le tuer. La bataille rituelle avec le diable devient une bataille sérieuse. L'idée principale est donc l'avertissement de George Sand de ne pas se jeter à corps perdu dans l'art, de ne pas vendre son âme au diable pour avoir du succès.
Un dernier aspect de la musique est son rôle d'amante exigeante. Ce motif largement répandu au dix-neuvième siècle47 se retrouve aussi dans ce roman: déjà, avant de partir dans le Bourbonnais, Joseph a ses préférences. Tiennet dit:
Il ne s'embarrassait d'aucune chose au monde que de sa musette et, en le voyant la plier avec soin et la regarder avec amour, je connus bien qu'il n'avait point d'autre amoureuse pour le moment.48
L'artiste doit choisir entre l'amour de la musique ou l'amour d'une femme. Brulette se plaint auprès de Thérence: "[j'ai] une rivale dont je serais vitement écrasée, et cette maîtresse [...] est la musique"49. Ces deux amours se contredisent. Ce n'est que par la dynamique qui résulte de cette contradiction que la statique romanesque et berrichonne est traversée, "le récit EST à partir de la musique"50. Elle est un moyen d'exprimer ses sentiments et de comprendre quelqu'un sans paroles, elle est le miroir d'un pays et de ses habitants, elle est dangereuse et belle, mystérieuse et simple: elle est la vie en toutes ses facettes.
Chapitre 3 Résumé
Après avoir analysé les différents aspects du roman, il faut en dégager l'impression générale et se poser la question de savoir si cette oeuvre a une intention. A première vue, on y découvre une sorte d'idylle, un hommage de George Sand à son Berry. Mais cela n'est pas tout. Elle nous donne une définition possible de l'artiste, c'est-à-dire son rôle de meneur. Lui, il s'évade du cadre dans lequel vivent les gens, il mène une vie extraordinaire, il subit des crises, cause de bonheur et aussi de chagrins. Le personnage de Joseph est le symbole de l'ambivalence tragique de l'artiste.
Peut-on considérer ce roman comme autobiographique? Il serait sûrement banal de dire que Chopin servait de modèle à Joseph et que George Sand exerçait sa vengeance sur le musicien en faisant mourir le personnage de Joseph. Seulement, si l'on se place à un niveau supérieur, on peut constater que, dans ces années-là, George Sand mettait fin à la vie mondaine qu'elle avait menée, ainsi elle assumait sa vie en exploitant ses expériences pour créer des romans, comme p.ex. "Elle et lui" (1856).
Il est évident que les Maîtres Sonneurs ne sont pas un roman philosophique, même si l'on discerne, ici et là, des facettes un peu cachées qui restent à découvrir et à analyser. On peut constater que c'est un roman qui veut distraire et qui sait distraire.
Chapitre 4 Bibliographie
1. ADAM, B. ET. J.-M.: Pour une analyse structurale du texte romanesque. Lecture des Maîtres Sonneurs de George Sand, dans: Le français aujourd'hui (janv. 1972), 36 - 41.
2. GAULMIER, JEAN: Poésie et vérité chez George Sand, dans: Revue des sciences humaines (oct. -déc. 1959), 345 - 358.
3. GAULMIER, JEAN: Un exemple d'utilisation immédiate du folklore: genèse et structure des Maîtres Sonneurs, dans: Société française de littérature comparée, Actes du sixième congrès national, Littérature savante et littérature populaire (1964), 143 - 150.
4. GUYARD, MARIUS-FRANCOIS: La genèse des Maîtres Sonneurs, dans: Revue des sciences humaines (janv. - mars 1954), 41 - 48.
5. LÜDICKE, HEINZ: George Sand als Heimatdichterin, Leipzig 1935.
6. PARENT, MONIQUE: George Sand et le patois berrichon, dans: Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg (avril - mai 1954), 57 - 102.
7. ROBERT, GUY: Etude de deux manuscrits de George Sand, dans: Annales littéraires de l'Université de Besançon, 2me Série, vol. 4 (1954), 26 - 60.
8. ROBERT, GUY: Les Maîtres Sonneurs. Composition, charme et leçon du récit, dans: L'information littéraire (janv. - févr. 1954), 6 - 12.
9. SAND, GEORGE: Les Maîtres Sonneurs, éd. folio classique, préface de Marie-Claire Bancquart, Gallimard 1979/1997.
10. VIERNE, SIMONE: Musique au coeur du monde ou le défi de la musique à l'écriture, dans: MOSELE, ELIO (ED.): George Sand et son temps. Hommage à ANNAROSA POLI. Vol. 2, Verona/Genève 1994.
11. VINCENT, MARIE-LOUISE: La langue et le style rustique de George Sand dans les romans champêtres, Paris 1916 (réimpression Genève 1978).
[...]
1 G. ROGER a éclairé tous les aspects d'une analyse dans son petit livre "Les Maîtres Sonneurs" (1954), qui donne une idée de la nature des Maîtres Sonneurs.
2 Cf. ROBERT, Composition (1954), ROBERT, Etude (1954), GUYARD (1954) et ADAM (1972).
3 Cf. GAULMIER (1959), DIDIER (1981) et LÜDICKE (1935).
4 Cf. PARENT (1954) et VINCENT (1916/1978).
5 Cf. GAULMIER (1965) et VIERNE (1994).
6 L'édition de BANCQUART fut publiée pour la première fois chez Gallimard en 1979 et ensuite rééditée dans la collection folio classique. J'ai donc employé cette édition pour ce travail.
7 Cf. le recueil minutieux de l'agenda de George Sand dans: GUYARD (1954), 43-45.
8 J'y reviendrai dans le chapitre sur la structure.
9 ADAM (1972), 37.
10 C'est sûrement George Sand qui nous parle à travers le grand bûcheux.
11 Les Maîtres Sonneurs, 485.
12 Les Maîtres Sonneurs, 66.
13 A la p. 66, Tiennet est jaloux de Brulette et de Joseph et à la p. 488, Joseph est jaloux des deux couples heureux.
14 Les Maîtres Sonneurs, 75 - 78.
15 Les Maîtres Sonneurs, 490.
16 Cf. ROBERT, Etude (1954), 40.
17 La transformation la plus importante, mais la plus banale, c'est bien sûr que les enfants deviennent des adultes.
18 Les Maîtres Sonneurs, 81.
19 Les Maîtres Sonneurs, 497.
20 D'après GUYARD (1954), 45.
21 Par l'étude de deux manuscrits des Maîtres Sonneurs, ROBERT a révélé que, à la rédaction finale,
George Sand remplaçait des expressions et formes standards par des formes relevant du patois ou de la langue ancienne. Cf. ROBERT, Etude (1954), 45ss.
22 Les Maîtres Sonneurs, 58 (dédicace).
23 Cf. PARENT (1954) et VINCENT (1916/1978).
24 Ce patois est certes un patois de langue d'oil, mais la frontière linguistique entre la langue d'oil et la langue d'oc ne passe qu'à quelques kilomètres au sud de Nohant.
25 Cf. VINCENT (1916/1978), 113 - 226. LÜDICKE critique cette distinction. A son avis, il est impossible de prouver quels mots étaient connus des Berrichons et quels ne l'étaient pas. Cf. LÜDICKE (1935), 100ss.
26 Cf. Les Maîtres Sonneurs, 268: "Je ne pouvais point...".
27 VINCENT (1916/1978), 109.
28 Cf. l'étude minutieux des indications topographiques chez GAULMIER (1959), 347 - 353.
29 George Sand s'occupait à Nohant d'un pauvre garçon, Joseph Corret et elle connaissait des gens qui s'appelaient Benoît, l'aubergiste, ou Etienne Depardieu, le chanvreur. La discussion sur la question, de savoir si Chopin était un modèle pour Joseph, n'a pas trop d'importance pour ce travail.
30 Mais ces passages sont toujours un peu plus tard expliqués par des faits réels et rationalistes. Cf. LÜDICKE (1935), 59. Seule la musique possède des forces inexplicables.
31 Cf. la description un peu méchante, mais exacte de LÜDICKE (1935), 39.
32 Au Berry p.ex. on se bat à coups de poings, "celui qui prend un bâton ou une pierre est réputé coquin et assassin" (Les Maîtres Sonneurs, 138), mais dans le Bourbonnais, une telle bataille est beaucoup plus violente et il y a même des morts. Cf. la bataille entre Huriel et Malzac (Les Maîtres Sonneurs, 259s.).
33 Elle est aussi présente dans la vie quotidienne des Berrichons qui méprisent un peu les muletiers bourbonnais, mais qui ont aussi peur d'eux.
34 Les Maîtres Sonneurs, 192.
35 Les Maîtres Sonneurs, 493.
36 LÜDICKE (1935), 30.
37 GAULMIER (1965), 150.
38 GAULMIER veut même discerner un rapport direct entre les figures d'une danse,p.ex. la bourrée berrichonne et les constellations des personnages du roman. Cf. GAULMIER (1965), 146 - 150.
39 Concernant la distinction de ‘musique naturelle’ et ‘musique savante’ cf. VIERNE (1994), 933ss.
40 Les Maîtres Sonneurs, 293.
41 Pour les Bourbonnais, les Berrichons ne sont que trop médiocres et techniciens. Huriel à Tiennet: "Vos airs sont fades et votre souffle écourté [...] car vous pensez que le monde finit à ces collines bleues qui cerclent votre ciel" (Les Maîtres Sonneurs, 140).
42 Les Maîtres Sonneurs, 294.
43 George Sand nous donne une première preuve lorsque Joseph estime que la musique de Carnat
maladroite ce que Tiennet ne peut pas comprendre, parce que, lui, il n'est pas capablé de comprendre et d'entendre la vraie musique. Cf. Les Maîtres Sonneurs, 106s.
44 Les Maîtres Sonneurs, 494.
45 Cf. Les Maîtres Sonneurs, 99s. et 119ss.
46 Cf. Les Maîtres Sonneurs, 470s.
47 Cf. BALZAC: "Le chef d'oeuvre inconnu" ou "La maison du chat qui pelote" ou ZOLA: "L'Oeuvre".
48 Les Maîtres Sonneurs, 127.
49 Les Maîtres Sonneurs, 242.
Foire aux questions - "Les Maîtres Sonneurs"
De quoi parle "Les Maîtres Sonneurs"?
Le roman "Les Maîtres Sonneurs" de George Sand explore la vie des habitants du Berry et du Bourbonnais, en particulier à travers la musique et les relations interpersonnelles. Il aborde des thèmes tels que l'amour, l'ambition artistique, les traditions régionales et la réconciliation des différences.
Quand George Sand a-t-elle écrit "Les Maîtres Sonneurs"?
George Sand a commencé à écrire "Les Maîtres Sonneurs" le 2 janvier 1853 à Nohant et l'a terminé le 26 février de la même année. Il a été publié en feuilleton dans "Le Constitutionnel" de juin à juillet 1853.
Quelle est la structure du roman?
Le roman est structuré en "veillées" (chapitres), comme si un grand-père, le vieux Tiennet, racontait son histoire pendant trente-deux soirées. L'action se déroule de manière chronologique, sans retours en arrière ni projections dans le futur.
Quel rôle joue la musique dans le roman?
La musique est un élément central du roman. Elle influence les personnages, provoque des transformations et est à l'origine de nombreux événements de l'histoire. Elle représente également une force mystérieuse et dangereuse, capable de conduire à la fois au succès et à la destruction.
Comment George Sand utilise-t-elle le langage régional dans "Les Maîtres Sonneurs"?
George Sand utilise avec modération des termes du patois berrichon ou des termes ayant un air régional pour donner une couleur locale à son récit, sans pour autant rendre le texte incompréhensible pour un public plus large. Elle emploie parfois des termes anciens du français pour créer une atmosphère paysanne.
Quelle est la signification de l'opposition entre le Berry et le Bourbonnais?
L'opposition entre le Berry et le Bourbonnais représente des modes de vie différents, des paysages contrastés et des caractères opposés. Les Berrichons sont dépeints comme plus calmes et réalistes, tandis que les Bourbonnais sont présentés comme plus vifs et artistiques. Le roman explore la réconciliation de ces deux mondes.
Qui est Joseph et quel est son rôle?
Joseph est un jeune homme du Berry fasciné par la musique. Son ambition artistique et sa passion le conduisent à quitter son village et à rechercher la maîtrise de son art. Son personnage symbolise l'artiste romantique, avec son génie, ses souffrances et sa fin tragique.
Le roman a-t-il une intention didactique?
Oui, le roman a une intention didactique. George Sand utilise les éléments régionaux et les personnages idéalisés pour présenter une vision romantique de la vie paysanne et pour proposer une réflexion sur le rôle de l'artiste et les dangers de l'ambition excessive.
Quels sont les principaux thèmes abordés dans le roman?
Les principaux thèmes abordés dans le roman sont: la musique, l'amour, l'amitié, l'ambition, le régionalisme, la tradition, la superstition, la réconciliation et le rôle de l'artiste.
Quelle est la source de l'information contenue dans ce document?
Ce document est un aperçu de l'analyse d'un roman, comprenant des éléments tels que le sommaire, les objectifs, les thèmes clés, les résumés de chapitres et les mots clés. Il cite des ouvrages critiques et des éditions spécifiques du roman "Les Maîtres Sonneurs" de George Sand.
- Citation du texte
- Alexander Schröer (Auteur), 1999, George Sand - Les Maîtres Sonneurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104526