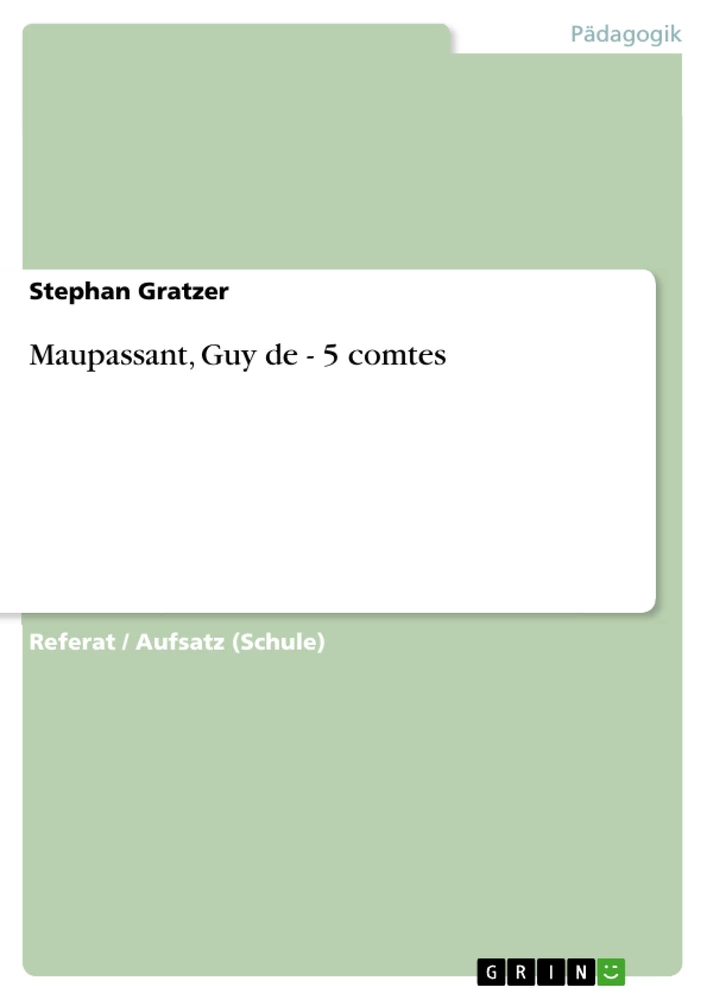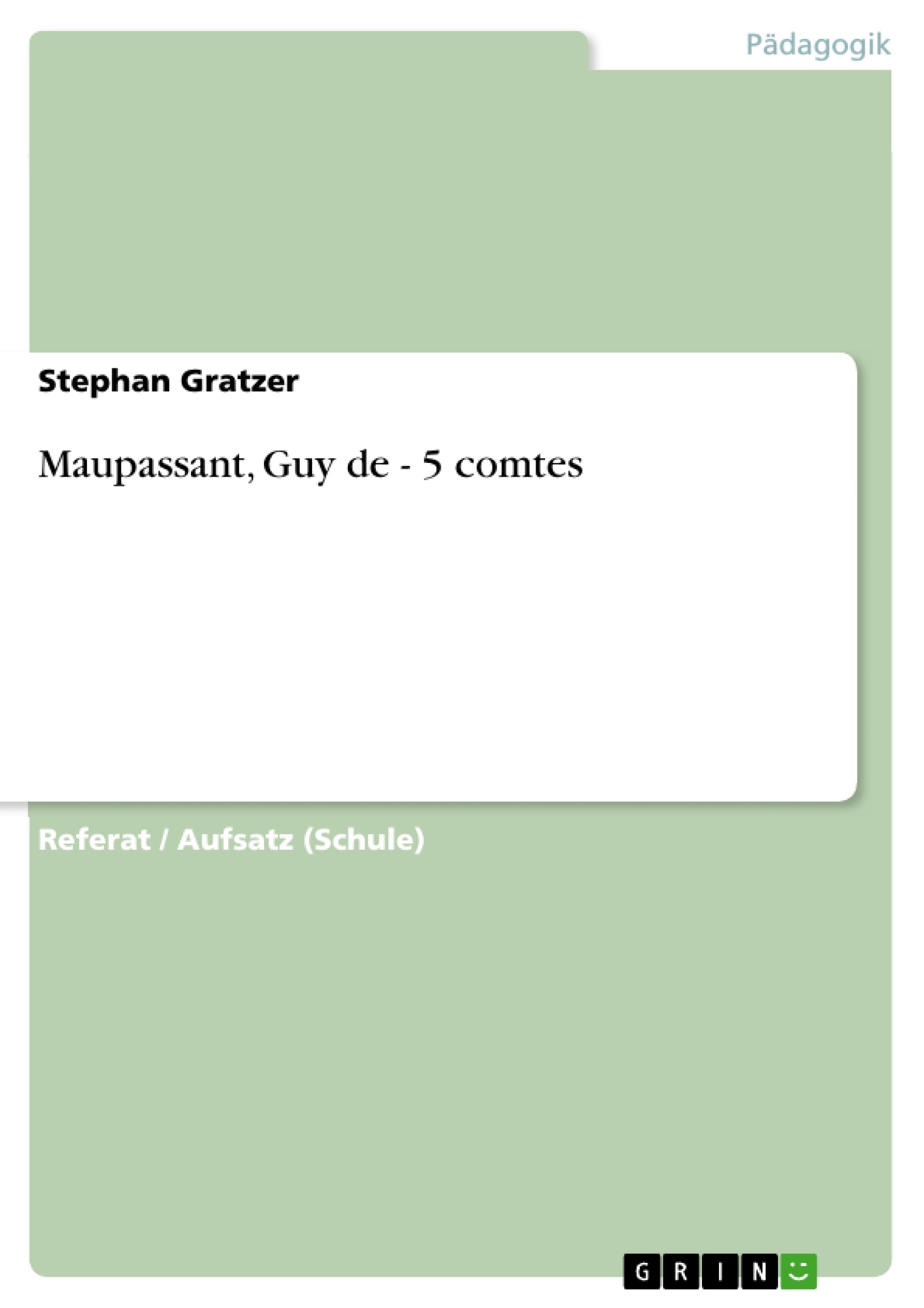Autor: Stephan Gratzer
Maupassant - La Parure
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Que signifie l'invitation ?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LA STRUCTURE :
Première partie : l'exposition
La description de la situation sociale de Mme Loisel (ses rêves et la réalité)
Deuxième partie : une invitation au bal
M. Loisel obtient l'invitation du Ministre de l'Instruction. Mme Loisel n'a pas de robe convenable, ni de bijoux. Son mari lui donne de l'argent pour acheter une robe
Troisième partie : La parure de Mme Forestier
Mme Loisel est mécontente parce qu'elle n'a pas de bijoux. M. Loisel lui propose de mettre des fleurs naturelles mais elle n'en veut pas. M. Loisel a l'idée d'emprunter des bijoux à son amie (Mme Forestier). Elle (Mme Loisel) trouve un superbe collier de diamants.
Quatrième partie : La soirée du bal
La soirée a été un grand succès pour Mme Loisel. Tous les hommes l'ont admirée et ils voulaient valser avec elle. Rentrée à la maison elle remarque qu'elle a perdu le collier.
Cinquième partie : La substitution de la parure
Ils cherchent partout le collier mais ils ne peuvent plus le retrouver. Ils cherchent un collier qui ressemble au collier perdu. Ne pouvant pas le payer ils doivent emprunter de l'argent. Mme Loisel rend le collier à son amie. Mme Forestier ne regarde pas dans l'écrin.
LA DÉCHÉANCE SOCIALE DE M. LOISEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ANALYSE STYLISTIQUE
Les temps
Temps narré temps de narration
-exposé ·(fin de la 1ère partie) ·accélération
-invitation · =
-le collier de Mme Forestier · accélération
-la soirée au bal · accélération
-la substitution · accélération
-les 10 ans de la déchéance · accélération
-rencontre aux Champs- Elysées · accélération
Mathilde
Rue des Martyres Champs- Elysées
-elle n'est pas contente de sa vie -elle est contente et fière de ne plus avoir de dettes
-elle rêve de la richesse -elle est grosse
-après avoir perdu le collier elle est inquiète
-elle est naïve
-elle est jolie, séduisante, gracieuse
LES RELATIONS DU COUPLE À TRAVERS L'HISTOIRE
-Mathilde est longuement introduite dans l'histoire (telle qu'elle est, avec ses rêves...), M. Loisel est seulement introduit comme petit commis (par sa fonction)
-Quand il arrive avec l'invitation, Mathilde est mécontente parce qu'elle n'a pas de toilette. Son mari cherche une solution.
-Pendant le bal elle s'amuse bien, il dort
-Après avoir perdu le collier, il l'aide à le retrouver
-Il partage la misère avec elle
MAUPASSANT
LE GUEUX:
Exposition :
La première phrase décrit l'époque où il avait encore de la chance. Un accident à l'age de 15 ans a changé la vie de Toussaint. Ses parents l'ont abandonné et le curé lui a sauvé la vie. Il vit comme un mendiant.
Le corps de la nouvelle :
-les 40 ans de l'infirmit é
la pitié de la baronne. Après la mort de la baronne il connaît l'hostilité des paysans
-la fin de Toussaint
Les paysans sont énervés de lui et ils se cachent quand ils le voient de loin. Les paysans veulent qu'il quitte leur village. Quand Toussaint voit des gendarmes il se cache et la nuit il reste sous les granges ou dans les étables. Avant que quelqu'un le remarque il déguerpit. Sa vigueur, qu'il a à cause de ses béquilles, l'aide beaucoup pour se cacher. Il vit entre les gens sans qu'ils le remarquent. Quand les paysans de son village ne lui donnent plus à manger il se met en route pour Tournelles mais quand il arrive au premier village qu'il doit parcourir, on ne lui donne rien. Dans sa détresse il tue une poule mais quand il la ramasse le maître de la ferme, Chiquet, veut l'abattre. Puis les autres gens de la ferme arrivent et tombent sur lui. Après quelques temps ils se séparent de lui et ils l'enferment pendant ils vont chercher les gendarmes. Le matin suivant les gendarmes le saisissent et l'enferment dans la prison du bourg mais personne ne lui donne à manger. Le lendemain quand on veut l'interroger il est mort.
>>les dernier jours de Toussaint
Toussaint a faim- il tue une poule- il est enfermé- il meurt de faim
La réaction des gens : Quelle surprise ! (ironique) (Ça veut dire « enfin », il sont contents d'être délibéré de lui
Interprétation :
Maupassant veut critiquer la société :
Il critique l'égoïsme des gens. Les gens ne veulent pas voir la réalité, qu'il y a des pauvres, de la misère, de la faim, des handicapés.
Toussaint est traité comme bête humaine.
Interprétation théologique :
- le nom Toussaint
- sa vie peut être comparé à un chemin de croix (il n'a pas été accepté par la société, il a été abandonné d'abord par ses parents, puis par la société. Il est mort tout seul.)
- Toussaint est le symbole de la créature qui souffre.
- Sa misère est le manque d'amour et le manque d'argent
- Il perd même l'usage de la langue. Son seul geste de communication est de tendre la main
Les temps de l'histoire
- les temps de la rétrospective (imparfait et plus-que-parfait)
- à la page 19, ligne 11commence le narrateur de la fin de Toussaint (passé simple)
MAUPASSANT
LA FICELLE :
STRUCTURE:
Introduction:
Page 23, 1- page 24, 12
La description des paysans et des paysannes.
La description d'une journée de marché
Le corps :
1. page 24, 13- page 25, 14
Maître Hauchecorne
Maître Hauchecorne ramasse une ficelle. M. Maladin, son ennemi, l'observe. ·l'action initiale
2. page 25, 15- page 27, 8
chez Jourdain
le dîner- le tambour arrive et annonce la perte d'un portefeuille- M. Hauchecorne doit suivre le brigadier
3. page 27, 9- page 28, 13
L'accusation :
Maître Hauchecorne est amené à la mairie. Il est accusé d'avoir ramassé le portefeuille perdu. Il le nie. On l'accuse de mentir. Maître Hauchecorne est confronté avec M. Maladin.
4. page 28, 14- page 28, 30
La nouvelle se répand, Maître Hauchecorne ne peut pas prouver son innocence
5. page 28, 31- page 28,16 (18)
le triomphe
quelqu'un a trouvé le portefeuille et le rapporte à son possesseur. Cela aurait pu être le dénouement
6. page 29, 17 (19)- page 30, 14
le soupçon reste
On prend la personne qui a trouvé le portefeuille pour un complice. Maître Hauchecorne raconte son histoire à tout le monde, mais on se moque de lui.
7. page 30, 15- page 30, 30
la fin de Maître Hauchecorne
il joue le rôle d'un clown, son état physique s'aggrave, finalement il meurt
Maître Hauchecorne :
Maître Hauchecorne est un vrai Normand, qui est très économe. Il ramasse tout. Il souffre de rhumatisme. Il a un ennemi. Il est obsédé de prouver son innocence. Il est un peu naïf parce qu'il ne veut pas croire à la méchanceté des hommes.
Le rôle de la société
- la société est responsable du malheur de Maître Hauchecorne
- à la fin, la société se moque d'un pauvre diable
- elle n'a pas de pitié du tout. (Même s'il avait volé le portefeuille, il l'a rendu. Mais on ne lui pardonne pas.)
- la société laisse s'influencer très vite de celui qui est plus fort et qui sait mieux convaincre.
- La société aime les faits sensationnels
- La société manque de sensibilité
- Les gens se comportent comme des moutons
L'image que Maupassant se fait de l'homme
Il est un être à peine plus supérieur aux autres.( une bête humaine)
Il est un être « condamné» à vivre seul (sans vrais amis)
MAUPASSANT
L'AVENTURE DE WALTER SCHNAFFS :
Expressions :
- il vivait ainsi dans la terreur et dans l'angoisse
- il resta immobile, surpris et éperdu
- le désir de détaler
- une torture en comparaison aux chèvres
- il sauta dans un fossé sans songer à la profondeur
- tapi comme un lièvre
personnage :
quand les francs- tireurs attaquent les Prussiens il est surpris parce qu'il a pensé à rien de mal. Au premier moment il reste sans mouvement parce qu'il est choqué mais quand il arrive à se remuer, il fuit. Il a peur et il tremble beaucoup. Il ne veut pas être un héros. Il veut survivre. Il est intimidé.
Au début :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Puis plus tard :
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Les mots qui décrivent comme il mange :
- mangeait par grandes bouchées
- il jetait à deux mains les morceaux dans sa bouche
- des paquets de nourriture lui descendaient coup sur coup dans l'estomac
- il est comme un tuyau trop plein
- il prenait la cruche de cidre et se délayait l'_sophage
POUR DÉCRIRE LA FAÇON DE MANGER, L'AUTEUR SE SERT D'IMAGES TRÈS CONCRÈTES. IL VEUT EXPRIMER QUE WALTER SCHNAFFS AVALE LA NOURRITURE COMME UNE BÊTE.
Le casque de Walter Schnaffs :
- le casque montre qu'il est Prussien
- le casque symbolise un danger pour Walter Schnaffs parce que la pointe peut le trahir
- le casque peut le sauver : les gens en ont peur
- le casque peut provoquer la haine des gens, parce que c'est le casque de l'ennemi
opposition de l'attitude des soldats à celle de Walter Schnaffs
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Walter Schnaffs porte l'uniforme et le casque prussien donc il est l'ennemi des soldats français. C'est pourquoi ils le traitent d'une façon violente et ridiculement prudente. Walter Schnaffs est content/ soulagé d'être enfin prisonnier. Il est épuisé parce qu'il a beaucoup mangé. D'abord il n'est plus capable de réagir. Quand les soldats le lient et quand il voit qu'ils sont armés il commence à avoir peur. À la fin, il est content qu'ils l'emmènent à la prison.
Le style de Maupassant
31,7 / 32,11-12/ 33,1-2/ 33,19/ 34,1/ 34,5-21 Il aime les constructions ternaires(p.ex. 3 questions, où, comment, de quel, tendresses, petits soins, baisers)
35,21-23/ 33,4/ 33,22/ 38,8-10 il aime les répétitions avec le même mot au début d'une phrase 33,16-18/ 33,22-28/ 35,9-10 Il aime répéter des mots clés (manger)
diagramme se la structure
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Le rôle de la guerre dans les contes de Maupassant
Dans 2 histoires : LA FOLLE et WALTER SCHNAFFS
Il s'agit de la guerre de 1870/ 1871 entre les Français et les Prussiens. Maupassant a participé lui même à cette guerre. Il veut montrer la peur, les souffrances (le regret de la famille, la faim, les occupants, la peur d'être blessé et de mourir, la haine des civilistes contre les soldats prussiens). La guerre fait souffrir aussi les gens qui ne sont ni coupable ni responsable, p.ex. « la folle». Sa maladie et la guerre rendent sa situation encore plus grave. Il écrit de la perspective d'un pacifiste.
Il décrit les Prussiens comme gens grossiers, violents, brutaux, d'une politesse froide (dans « la folle »), naïfs, des gens qui aiment vivre tranquillement (« Walter Schnaffs »). La différence est que les soldats prussiens (dans « la folle ») sont sévères, tandis que les soldats français (dans »Walter Schnaffs »·scène dans le château) sont ridiculisés.
Les héros (de guerre) dans les histoires de Maupassant et «le déserteur»de Boris Vian
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LES DEUX SONT PACIFISTE
Walter Schnaffs n'est pas un héros
- il est trop égoïste
- il est trop lâche pour se battre
- il est paresseux
- il n'est pas du tout sportif
- il n'est pas tellement patriote
MAUPASSANT
LA FOLLE :
Le cadre :
M. Mathieu d'Endolin, le voisin d'une malade raconte l'histoire
Les lieux :
Premier lieu : la maison où habite le narrateur et la malade
Après : pendant l'action de l'histoire c'est la chambre de la femme
A la fin : la forêt
Les temps :
Le début : 15 ans avant la guerre franco- allemande
L'histoire principale : en hiver 1870 sous l'occupation des Prussiens
La fin : 1 an après la fin de la guerre en automne
L'histoire découpée en 4 séquences
-1- La description de la maladie de la femme et les raisons de cette maladie (la mort de son mari, de son père et de son enfant)
-2- L'arrivée des soldats allemands et le logement chez la femme. Le commandant veut forcer la femme à descendre, elle n'obéit pas. Il pense que c'est par antipathie. Il lui lance un ultimatum.
-3- Le commandant fait porter la femme dans la forêt avec son matelas.
-4- Le narrateur se fait des soucis parce qu'il ne voit plus la femme. L'automne suivant - pendant la chasse- il trouve une tête de mort. Il est sûr que c'est sa tête.
Ce qu'on apprend de la personne du narrateur :
- il s'appelle Mathieu d'Endolin
- il habite près de Cormeil
- il est le voisin de la folle
- il est une personne sensible ·puisqu'il a de la pitié pour la folle et parce qu'il garde un souvenir d'elle (l'ossement).
- c'est une personne intelligente : il essaie d'avoir des nouvelles de la folle (·demande aux Prussiens) et puis il devine ce qui s'est passé.
- Il est père de plusieurs fils.
Les mots qui donnent l'idée que la femme ait morte :
- Page 42 ligne 7 « ...il se mit à rire et donna des ordres en allemand... »
- Page 42 ligne 17 « ...le cortège dans la direction de la forêt d'Imauville... »
- Page 42 ligne 19 « ...les soldats revinrent tout seuls... »
- Page 42 ligne 21 « On ne le sait jamais. »
- Page 42 ligne 23 « Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. »
- Page 42 ligne 27 « Je faillis être fusillé. »
La thèse, de la mort, du narrateur :
A son avis il l'ont seulement laissée dans la forêt et comme elle ne voulait plus jamais bouger elle mourrait allonger sous la neige. Puis les cadavres ont été mangés par les animaux des bois ! L'explication du narrateur est croyable et logique. Il n'a pas de haine contre les Prussiens puisqu' après sa thèse ils ont seulement abandonné la folle dans la forêt et ils ne l'ont pas tuée ! Le narrateur est marqué par cette aventure et ne veut plus jamais voir la guerre.
Le conflit entre le soldat et la femme
Au début : Il la prie de se lever. Il accepte qu'elle reste dans son lit. Il reste indifférent
Puis ? Puis il commence à se fâcher. Il ne tolère plus qu'elle reste coucher. Puis il s'enrage. Il l'intimide. Puis il se met en colère. Il donne des ordres.
Questions fréquemment posées
Quels sont les thèmes principaux de l'analyse de "La Parure" de Maupassant par Stephan Gratzer ?
L'analyse explore la structure du récit (exposition, invitation au bal, la parure, soirée du bal, substitution), la déchéance sociale de M. Loisel, l'analyse stylistique (temps de narration, évolution de Mathilde), les relations du couple, et l'interprétation des œuvres de Maupassant.
Comment la structure de "La Parure" est-elle décomposée ?
Elle est divisée en cinq parties : l'exposition (description de la situation sociale de Mme Loisel), une invitation au bal (acquisition de la robe et des bijoux), la parure de Mme Forestier (emprunt du collier), la soirée du bal (succès de Mme Loisel et perte du collier), et la substitution de la parure (recherche et remplacement du collier).
Quel rôle joue Mathilde dans "La Parure", et comment évolue-t-elle ?
Au début, elle est insatisfaite de sa vie, rêve de richesse, et est décrite comme jolie, séduisante et gracieuse. Après la perte du collier, elle devient inquiète, travaille dur pour rembourser les dettes, et à la fin, est contente et fière de ne plus avoir de dettes, bien qu'elle soit devenue plus grosse.
Comment les relations du couple Loisel sont-elles présentées dans l'histoire ?
Mathilde est longuement introduite avec ses rêves, tandis que M. Loisel est présenté comme un petit commis. M. Loisel cherche des solutions aux problèmes de Mathilde. Pendant le bal, elle s'amuse, et il dort. Après la perte du collier, il l'aide à le retrouver et partage la misère avec elle.
Quels sont les principaux éléments analysés dans "Le Gueux" de Maupassant ?
L'analyse porte sur l'exposition (la vie de Toussaint avant et après son accident), le corps de la nouvelle (les 40 ans d'infirmité, la fin de Toussaint), la réaction des gens, l'interprétation (critique de l'égoïsme de la société), et l'interprétation théologique (la vie de Toussaint comparée à un chemin de croix).
Comment Maupassant critique-t-il la société dans "Le Gueux" ?
Il critique l'égoïsme des gens qui ne veulent pas voir la réalité de la pauvreté et de la misère. Toussaint est traité comme une bête humaine, et la société l'abandonne.
Quels aspects sont mis en évidence dans l'analyse de "La Ficelle" de Maupassant ?
L'analyse se concentre sur la structure de la nouvelle (introduction, corps), le personnage de Maître Hauchecorne (sa personnalité, son obsession de prouver son innocence), le rôle de la société (responsable du malheur de Maître Hauchecorne), et l'image que Maupassant se fait de l'homme (un être condamné à vivre seul).
Comment la société est-elle dépeinte dans "La Ficelle" ?
La société est responsable du malheur de Maître Hauchecorne, se moque de lui, manque de pitié et se laisse influencer par ceux qui sont plus forts et savent mieux convaincre. Elle est décrite comme aimant les faits sensationnels et manquant de sensibilité.
Quels sont les thèmes explorés dans "L'Aventure de Walter Schnaffs" ?
L'analyse met en lumière les expressions utilisées par l'auteur, le personnage de Walter Schnaffs (sa peur, son désir de survivre), sa façon de manger (décrite de manière concrète pour exprimer son comportement animal), le rôle du casque, et l'opposition entre l'attitude des soldats et celle de Walter Schnaffs.
Comment Walter Schnaffs est-il dépeint comme personnage ?
Il est dépeint comme quelqu'un de surpris, peureux, tremblant, et plus intéressé par la survie que par l'héroïsme. Il est intimidé, égoïste, lâche, paresseux, pas sportif et peu patriote.
Quels aspects du style de Maupassant sont soulignés ?
L'analyse mentionne son utilisation de constructions ternaires, de répétitions avec le même mot au début des phrases, et la répétition de mots clés.
Quel rôle joue la guerre dans les contes de Maupassant analysés ?
La guerre de 1870/1871 entre la France et la Prusse est un thème central. Maupassant montre la peur, les souffrances, la haine des civils contre les soldats prussiens, et l'impact de la guerre sur les personnes innocentes comme "la folle". Il écrit depuis une perspective pacifiste.
Comment les Prussiens sont-ils décrits dans les contes de Maupassant ?
Dans "La Folle", ils sont décrits comme grossiers, violents, brutaux, et d'une politesse froide. Dans "Walter Schnaffs", ils sont naïfs et aiment vivre tranquillement.
Quels sont les éléments clés de l'analyse de "La Folle" ?
L'analyse se concentre sur le cadre (le narrateur M. Mathieu d'Endolin), les lieux, les temps, la structure de l'histoire (description de la maladie, arrivée des Allemands, la femme emportée dans la forêt), ce qu'on apprend du narrateur, les indices de la mort de la femme, et le conflit entre le soldat et la femme.
Comment la folie de la femme est-elle reliée à la guerre dans "La Folle" ?
La maladie de la femme est exacerbée par la guerre et l'occupation prussienne. Sa situation déjà précaire est aggravée par la présence des soldats et les événements tragiques de la guerre.
- Quote paper
- Stephan Gratzer (Author), 2000, Maupassant, Guy de - 5 comtes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103118