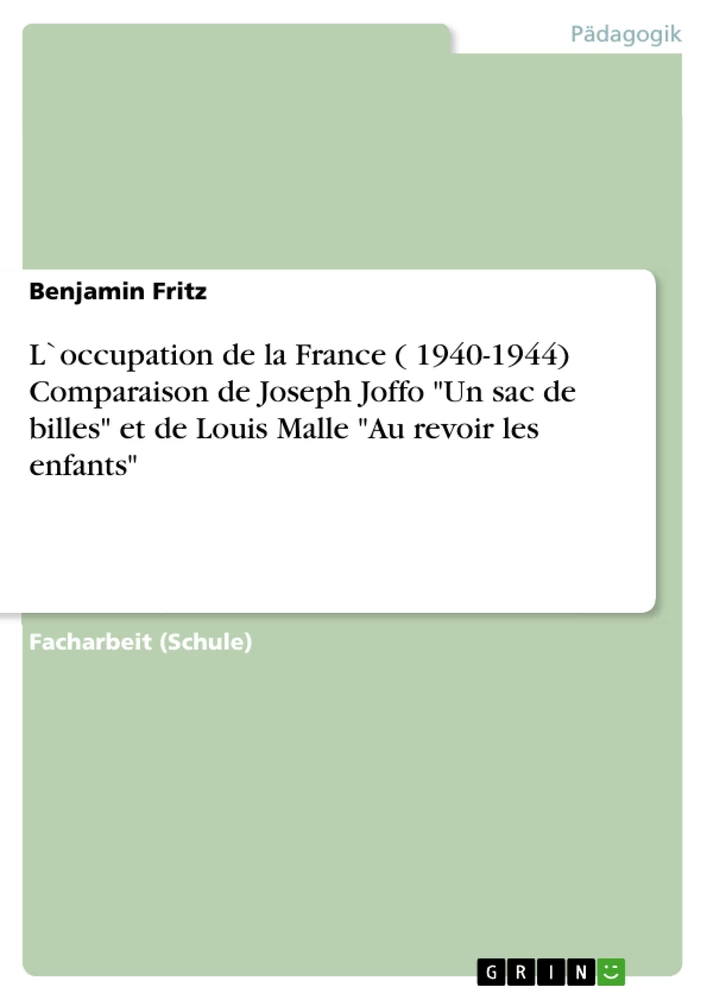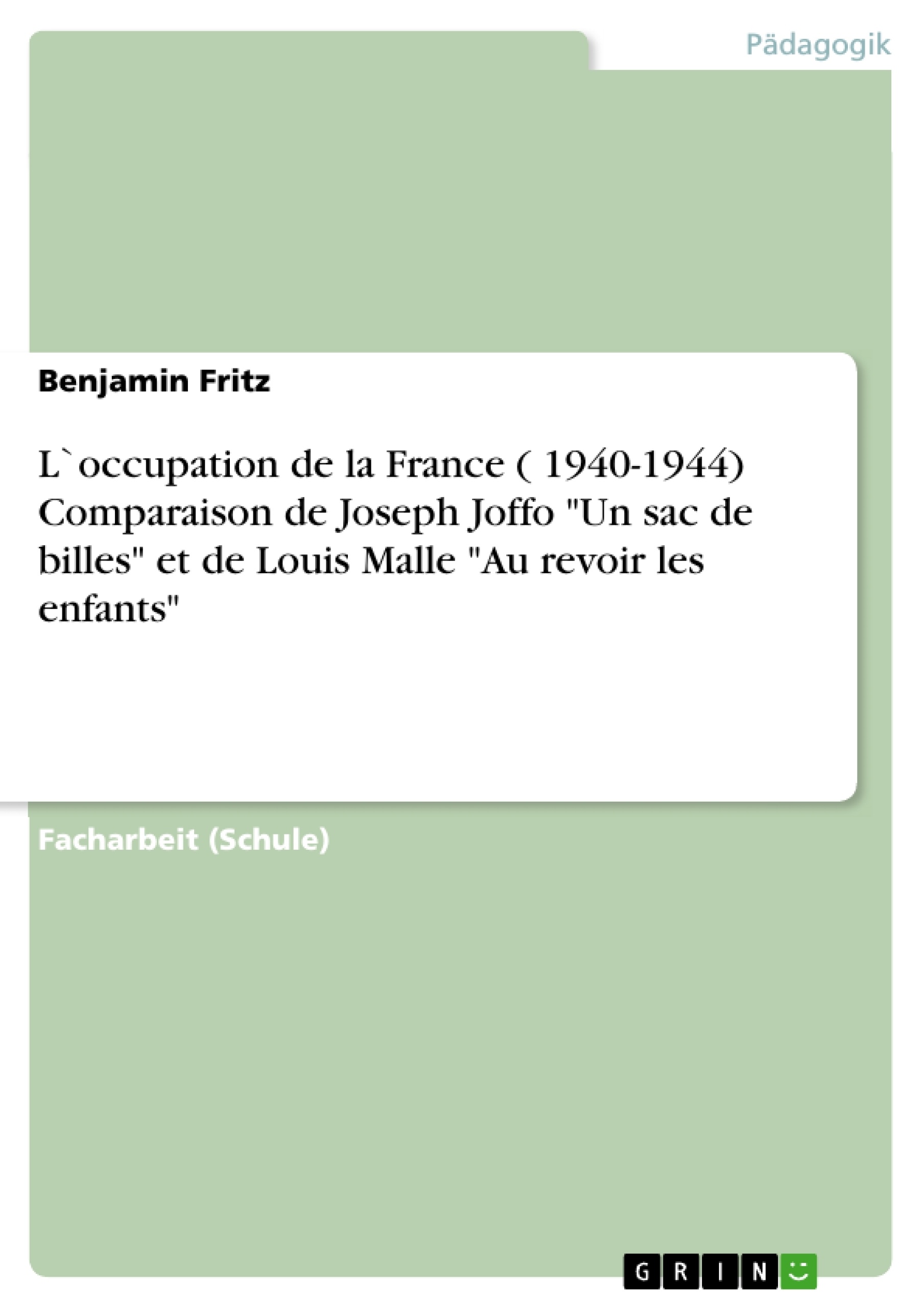Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind, dessen Welt sich plötzlich in ein gefährliches Labyrinth verwandelt. Genau dieses Schicksal ereilt die jungen Protagonisten in diesen zwei ergreifenden Erzählungen über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs im besetzten Frankreich. „Ein Sack voller Murmeln“ und „Auf Wiedersehen, Kinder“ – zwei Werke, die auf unterschiedliche Weise die Grausamkeit des Krieges und den Verlust der Unschuld thematisieren. Während Joseph Joffos autobiografischer Roman die abenteuerliche Flucht zweier jüdischer Brüder vor den Nazis schildert, beleuchtet Louis Malles Film-Drehbuch die tragische Geschichte einer Freundschaft in einem katholischen Internat, das jüdische Kinder versteckt. Beide Werke fangen die allgegenwärtige Angst, den Verrat und das verzweifelte Überleben ein. Doch während der eine Text die subjektive Perspektive eines Kindes einnimmt, das die Welt mit unvoreingenommenen Augen sieht, präsentiert der andere eine distanziertere, beobachtende Sichtweise auf die Ereignisse. Untersuchen Sie, wie diese unterschiedlichen Erzählperspektiven unsere Wahrnehmung der deutschen Besatzer und die Rolle der Kirche beeinflussen. Entdecken Sie, wie Mut, Widerstandskraft und die Suche nach Menschlichkeit in einer Zeit der Dunkelheit dargestellt werden. Vergleichen Sie die stilistischen Mittel, mit denen die Autoren arbeiten, um die Atmosphäre der Angst und Unsicherheit zu vermitteln. Tauchen Sie ein in eine Analyse, die nicht nur die historischen Hintergründe beleuchtet, sondern auch die tiefgreifenden emotionalen Auswirkungen des Krieges auf die betroffenen Kinder und ihre Familien. Erfahren Sie, wie diese beiden Werke dazu beitragen, die Erinnerung an eine dunkle Epoche wachzuhalten und die Bedeutung von Toleranz und Mitmenschlichkeit zu betonen. Diese vergleichende Studie bietet einen tiefen Einblick in zwei Meisterwerke, die auf bewegende Weise die Herausforderungen und das Leid der Kinder während des Holocausts vergegenwärtigen und zum Nachdenken über die Grausamkeiten des Krieges anregen, wobei die Notlage der Juden und die Gräueltaten der Nazis im Frankreich der 1940er Jahre im Fokus stehen. Die Résistance, Verstecke und die ständige Angst vor Entdeckung prägen die Handlung, während die Protagonisten um ihr Überleben kämpfen.
Table de matières:
1 Introduction
2 Partie principale
2.1 Résumé de « Un sac de billes »
2.2 Résumé de « Au revoir, les enfants »
2.3 L'arrière-plan historique
2.4 Comparaison de la forme
2.5 Comparaison de la description des Allemands
2.5.1 Les Allemands dans « Au revoir, les enfants »
2.5.2 Les Allemands dans « Un sac de billes »
2.6 Le rôle de l'église
3 Remarque finale
4 Table de littérature
1 Introduction
Sur les pages suivantes, je m'occuperai de l'occupation de la France pendant la Deuxième Guerre Mondiale et des conséquences pour la population française comme elles sont décrites dans les deux livres. Ce sujet a déjà très souvent été discuté et il est aussi difficile et délicat mais je l'ai choisi quand même parce que je m'intéresse beaucoup à cette époque-là. J'avais déjà lu le texte réduit de « Sac de billes » et en remarquant qu'il y a une ressemblance évidente de ce texte et du livre que nous avons lu au cours de français, je me suis décidé à écrire mon "Facharbeit" sur ce sujet. Les deux textes sont presque pareils dans quelques aspects - ce qui concerne le contenu. Mais nous examinerons cela plus tard. En plus, je veux éclairer un peu l'arrière-plan historique parce que c'est le moindre à faire pour comprendre la situation et les sentiments des personnages.
2 Partie principale
2.1 Résuméde « Un sac de billes »
Le roman « Un sac de billes » de Joseph Joffo est une autobiographie. Joffo l'a publié en 1973. L'action se passe pendant l'occupation de la France dans les années quarante. Joseph, ayant dix ans au début de l'histoire, et son frère Maurice (12 ans) sont les personnages principaux.
À cause de l'occupation allemande, les deux frères doivent quitter Paris (ils sont battus à l'école parce qu'ils sont juifs.) et ils doivent franchir la ligne de démarcation. Mais ils partent sans leurs parents parce que le père trouve qu'il vaut mieux que la famille se sépare. Les deux frères prennent le train pour Dax dans lequel les Allemands font des contrôles de papiers. N'ayant pas de papiers, les deux jeunes trouvent un prêtre qui les aide à passer le contrôle en disant qu'ils l'accompagnent. Arrivés à Dax, ils quittent le prêtre et franchissent la ligne à Hagetmau à l'aide d'un garçon d'une quinzaine d'années. De là, ils partent pour Menton où leurs frères, Henri et Albert, habitent. Mais ils ne peuvent pas rester longtemps. Alors, ils doivent partir pour Nice où toute la famille se réunit. Nice est occupée par l'armée italienne et dès que l'Italie fait partie des Alliés, les Italiens quittent la France et les Allemands y arrivent pour l'occuper.
Ainsi, les Joffo doivent s'enfuir de nouveau : Maurice et Joseph s'en vont à un camp s'appelant « Moisson Nouvelle » à Golf-Juan, tout près de Nice, une sorte d'annexe des Compagnons de France qui était une organisation paramilitaire, et qui dépendait du gouvernement de Vichy. Les parents se cachent à Nice.
Il ne se passe rien de mal jusqu'à ce que les deux frères accompagnent un ami à Nice dont ils ne savent pas qu'il est juif. Il veut acheter des faux papiers et il est arrêté par les Allemands avec Maurice et Joseph. Ils sont emmenés à l'hôtel Excelsior à Nice où se trouve le siège de la Gestapo niçoise. Quand ils sont interrogés, Joseph et Maurice nient qu'ils sont juifs. Et de nouveau, un prêtre les aide en leur fournissant de faux certificats de la communion, et après être emprisonnés pendant plus d'un mois, ils sont remis en liberté.
Ils décident d'aller chez leur s_ur qui habite près de Monluçon, dans le Nord de l'Auvergne. Mais ils ne peuvent pas y rester à cause d'un dénonciateur. Ils reviennent dans la région de Nice où ils restent jusqu'à la fin de la guerre. Là, ils font aussi la connaissance de la Résistance. Enfin, en 1944, ils retournent à Paris et la famille se réunit sans le père qui est mort entre- temps.
2.2 Résuméde « Au revoir, les enfants »
« Au revoir, les enfants » de Louis Malle est un scénario avec des éléments autobiographiques. Malle l'a publié en 1987.
L'action se passe en 1944 à Paris et plus tard en Île-de-France.
Les protagonistes sont Julien (12 ans), qui joue le rôle de Louis Malle, et Jean ayant aussi environ 12 ans.
L'histoire commence vers la fin des vacances de Noël. A la gare, Julien prend congé de sa mère. Il part pour l'internat qui se trouve dans une petite ville en Île-de-France. C'est un internat catholique (Couvent des Carmes) dirigé par des moines. Au début de l'année scolaire il y a aussi des nouveaux « camarades ». Un de ces nouveaux, Jean, occupe le lit près de Julien.
D'abord, Julien est très réservé envers Jean. Puis, Julien découvre que Jean ne s'appelle pas
« Bonnet » comme il dit, mais « Kippelstein ». Julien commence à s'intéresser á Jean et, ayant les mêmes intérêts, ils deviennent amis. Jean raconte que son père est en prison et sa mère a disparue.
Comme plusieurs autres élèves du collège, Julien lui aussi fait du marché noir avec le marmiton, Joseph. Ce garçon est le plus faible du collège, donc les autres le battent tout le temps. Enfin, quand le père Jean, le « directeur » du collège, dévoile le marché noir et découvre que Joseph vole, il le met à la porte en ne punissant guère les élèves qui se sont aussi embrouillés dans l'affaire.
Donc, Joseph, n'ayant ni plus de travail ni de domicile, trahit le collège et les moines en révélant aux Allemands que des Juifs et des réfracteurs s'y cachent.
Alors, les Nazis ferment le collège et déportent les Juifs cachés y compris Jean. En plus, ils arrêtent le père Jean parce qu'il a caché des Juifs et parce qu'il a coopéré avec la Résistance. (les Allemands trouvent du matériel de la Résistance chez lui)
L'auteur finit le scénario avec ces mots donnant une évaluation finale:
« [...] jusqu'à ma mort je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. »
2.3 L'arri è re-plan historique
L'action des deux livres se passe en France occupée pendant les années quarante, c'est-à-dire de 1941 jusqu'à 1944.
Les Allemands ont commencé à attaquer l'ouest de l'Europe à partir du 10 mai 1940.
Seulement six semaines après, la France a demandé l'armistice qui a été signé le 22 juin 1940. La France a alors été divisée en deux parties : la zone occupée et la zone « libre ». Le 2 juillet 1940, Philippe Pétain, un maréchal connu et populaire ayant fait carrière militaire formidable, a installé un nouveau régime à Vichy dans la zone dite libre. Il en avait eu la permission d'Hitler qu'il a rencontré personnellement le 24 octobre 1940 à Montoire-sur-le- Loir près de Tours. Après avoir obtenu toutes les procurations exécutives et législatives, il a exercé une dictature en collaborant avec le régime Nazi allemand. Dès le mois de juin 1942, le gouvernement de Vichy a aidé les Allemands à déporter des Juifs et leur a envoyé de la main-d'_uvre. En novembre 1943, les Allemands ont aussi occupé la zone libre et ont remplacé Pétain par des fascistes radicaux.
Enfin, en 1944, après le débarquement des Alliés en Normandie, la France a été libérée et le gouvernement de Vichy s'est écroulé.
2.4 Comparaison de la forme
Je m'occuperai seulement superficiellement de ce sujet afin de ne pas dépasser la longueur prescrite de ce devoir.
Sans tenir compte du contenu des textes on peut déjà constater une différence essentielle :
« Un sac de billes » est un roman de onze chapitres et de 380 pages tandis que « Au revoir, les enfants » est un scénario composé de 53 scènes et de 123 pages.
Le roman de Joffo a donc un volume qui est trois fois plus grand que lequel du scénario de Malle.
D'un côté, le scénario de Malle contient de loin plus de dialogues que le roman de Joffo, de l'autre côté, les descriptions de lieu, de temps etc. dans « Au revoir, les enfants» sont très courtes et objectives. Une raison pour cette objectivité est que Malle utilise la 3e personne ne décrivant ni sentiments ni pensées. Il y a seulement des descriptions des expressions et du comportement des personnages. Par conséquent, le lecteur peut seulement imaginer ce qui se passe dans les têtes des caractères. Par ces moyens, Malle maintient une distance critique entre le spectateur/lecteur et l'action.
Les dialogues sont en français familier ou populaire. Il y a aussi du langage argotique utilisé par Joseph. Il ne règne pas du tout la grammaire. C'est aussi un moyen stylistique de Malle pour influencer l'impression du côté lecteur.
Joffo raconte dans la 1ère personne. C'est pourquoi il peint tous ses sentiments et ses pensées. Les descriptions qu'il donne sont parfois très précises et détaillées (J. 254/255), mais quelquefois aussi très brèves, contenant seulement l'essentiel (J. 139 au milieu). Cela dépend de l'évaluation de l'auteur. Comme les descriptions, qu'il donne, et les récits sont très individuels et subjectifs, on voit tout par les yeux de l'auteur. Ainsi, Joffo évoque une identification du lecteur avec les personnages et leurs situations.
Donc, Malle appelle à l'intelligence et à l'imagination du lecteur qui doit se faire son propre opinion. L'auteur ne donne pas de propositions.
Joffo en revanche s'adresse aux sentiments du lecteur et lui montre l'opinion juste ce qui fait du roman un texte presque pédagogique.
2.5 Comparaison de la description des Allemands
2.5.1 Les Allemands dans « Au revoir, les enfants »
Dans ce texte là, les Allemands sont presque toujours les ennemies des Français. Il y a seulement un élève (Sagard) étant de l'avis que « les Juifs et les communistes sont plus dangereux que les Allemands » (M. 46 ; 10f)1. On pourrait demander maintenant : Et qu'est-ce qu'il y a avec Joseph ? Oui, il collabore avec les Allemands mais il agit ainsi parce qu'il n'a pas d'autre choix (de sa perspective) et aussi pour se venger du père Jean qui l'a mis à la porte. Mais à mon avis, il est indifférent envers les Allemands - tout lui est égal. [Son commentaire quand les Allemands ont arrêté les Juifs : « Fais pas le curé, j' te dis. C'est la guerre, mon vieux » (M. 119 ; 2f)]
Les autres n'aiment pas les Allemands : Les élèves ont peur d'eux (M. 48 ; 4f) et les moines les détestent pour ce qu'ils font avec les Juifs et autres « ennemies » du « Führer ». Les Allemands se comportent presque tout égaux :
Ils sont très autoritaires [« Halt! » (M. 110 ; 7) ; « Schnell! » (M. 113; 23); « Schnell, Jude! » (M. 114; 15) ; « Halt » (M. 110 ; 7) etc.], même envers leurs collaborateurs. [ « Zwei Minuten. » (M. 118; 10)]
Ils sont toujours sérieux ; on ne trouve aucun Allemand riant ou seulement souriant dans tout le livre. Leur travail est totalement discipliné [« La discipline est la force du soldat allemand » (M. 121 ; 4f)] et systématique (p. 120). Ça se voit aussi quand les deux soldats allemands entrent dans l'infirmerie (p. 115/116). Ils pourraient s'en aller n'ayant pas trouvé de Juifs mais ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent un Juif. C'est alors leur propre décision dont ils sont coupables. Donc, les soldats allemands sont aussi convaincus de leur idéologie. Mais ils sont équitables envers les Français quand ils amènent Julien et Jean au collège (p. 72).
La scène dans le restaurant montre l'arbitraire de quelques Allemands, dans ce cas concernant la chasse aux Juifs : L'officier veut seulement impressionner la mère de Julien en sauvant M. Meyer. (M. 89 ; 14)
Dans certaines scènes, les Allemands sont aussi très brutaux par exemple en poussant « brutalement le Père Jean dans la rue » (M. 123; 4).
2.5.2 Les Allemands dans « Un sac de billes »
Ici, la description des Allemands est, comme tout, influencée par l'opinion de Joseph. Puisque Joseph n'a que dix ans au début, il est encore très naïf et crédule. Mais ça a aussi l'avantage que ses descriptions n'ont pas de préjugés : (après l'arrestation à Nice dans la rue Russie) « Ce que je comprends le moins, c'est la violence de ce soldat. [...] On ne s'est jamais vus 2 , je ne lui ai rien fait et il veut me tuer. » (J. 252 au milieu)3
Il ne comprend pas pourquoi les Allemands chassent les Juifs mais il a conscience du danger venant des Allemands.
Dans « Un sac de billes » la plupart des Allemands sont aussi autoritaires [« Dehors, vite, vite. »; « Vite, vite. » (J. 254 en haut)] et brutaux. [« A toute volée, il me catapulte contre une porte latérale qui vibre sous le choc. » (J. 247 en bas) ; « A la volée, sa main claque sur la joue terreuse de Ferdinand, la tête ballotte et à la deuxième gifle, il chancelle et recule de deux pas. Les larmes coulent. » (J. 261 en haut)]
Quand même, il y a un Allemand étant sérieux ce qui concerne son travail mais en parlant avec le prêtre, il « rit » (J. 70 en haut) et est très gentil.
La façon de laquelle les Allemands travaillent est systématique et consciencieuse (J. 261- 288) : Ils tiennent les deux frères pour presque un mois en détention pendant lequel ils les interrogent d'innombrables fois. Quelle dépense pour deux enfants !
Ils emploient tous moyens pour atteindre leur but. Ainsi, ils menacent Maurice en lui disant qu'ils découperaient Joseph « en morceaux » si Maurice ne revenait pas après 48 heures. (J. 288 en haut)
Quant aux miliciens, Joffo dit seulement :
« Ceux-là sont les plus détestés, ce sont les chasseurs de résistants, les miliciens. » (J. 349 en bas)
Dans les deux textes, les Allemands se comportent presque pareils. La seule différence est que, dans « Un sac de billes », on les voit par les yeux d'un enfant alors que, dans « Au revoir, les enfants », ils sont décrits objectivement.
2.6 Le r ô le de l'église
Dans les deux textes, l'église ou ses représentants aident les protagonistes.
Les moines cachent Jean (et aussi autres Juifs) au collège lui donnant aussi une nouvelle identité. En plus, ils logent un réfracteur (Moreau).
Le prêtre dans le train aide Joseph et Maurice à passer le contrôle allemand (J. 69/70) et le « curé de Buffa » leur procure des faux certificats (J. 290/291).
L'église a un rôle très important dans les deux textes parce qu'elle se place entre les Allemands et les Juifs. Elle fait ça parce que les Allemands enfreindrent le premier principe de l'église : la charité. Ils tuent des gens innocentes et elle ne peut pas ça tolérer. Comme les Allemands dans « Un sac de billes » se passent des prêtres pour ne pas avoir de difficultés avec l'église, les prêtres ont peu de problèmes à tromper les Allemands (comme on le voit dans le train).
Dans « Au revoir, les enfants » en revanche, ils n'estiment pas l'église par exemple en perquisitionnant le collège sans demander.
Néanmoins, les Allemands ont tué assez de prêtres pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Un de ces était le père Jean.
3 Remarque finale
En conclusion, je pense que les deux textes se ressemblent dans beaucoup d'aspects.
Bien que la forme générale (autrement dit, dont on s'aperçoit sans analyser longtemps) ne soit pas la même (scénario - roman), le contenu montre de certaines ressemblances : Presque le même lieu, le même temps et aussi la même situation.
Tous les deux textes relatent les expériences des auteurs du temps le plus terrible dans leurs vies. J'espère que tout ce qui s'est passé à cette époque-là, ne se reproduira plus jamais et je suis convaincu que ces deux livres peuvent aider à atteindre ce but au moins en rappelant aux lecteurs l'atrocité que les Juifs ont dû supporter.
4 Table de littérature
1. Malle, Louis : « Au revoir, les enfants », 1987, Paris
2. Joffo, Joseph : « Un sac de billes », 1973, sans lieu
3. Microsoft Encarta 99 plus, version allemande (utilisé à la page 5
Foire aux questions
De quoi parle "Un sac de billes" et "Au revoir, les enfants"?
Ce document est une analyse comparée de deux œuvres traitant de l'occupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences sur la population française : "Un sac de billes" de Joseph Joffo et "Au revoir, les enfants" de Louis Malle. Il comprend une table des matières, une introduction, des résumés des deux œuvres, un éclairage sur l'arrière-plan historique, une comparaison de la forme des deux œuvres, une comparaison de la description des Allemands dans chaque œuvre, une analyse du rôle de l'église, et une conclusion.
Quels sont les résumés des deux œuvres?
"Un sac de billes" est une autobiographie de Joseph Joffo racontant l'histoire de deux jeunes frères juifs qui tentent de survivre en France occupée. "Au revoir, les enfants" est un scénario de Louis Malle, avec des éléments autobiographiques, qui se déroule dans un internat catholique pendant la guerre et se concentre sur l'amitié entre deux garçons, dont l'un est juif caché.
Quel est l'arrière-plan historique présenté dans le document?
Le document résume l'occupation de la France par l'Allemagne à partir de 1940, la division du pays en zones occupée et libre, la collaboration du gouvernement de Vichy avec les Nazis, et la libération de la France en 1944.
Comment la forme des deux œuvres est-elle comparée?
Le document compare "Un sac de billes" (un roman) à "Au revoir, les enfants" (un scénario). Il note que le roman est plus long et contient plus de descriptions détaillées, tandis que le scénario est plus axé sur les dialogues et les descriptions objectives. Le style narratif est également différent: Joffo raconte à la première personne, rendant le récit subjectif et émotionnel, tandis que Malle utilise la troisième personne, créant une distance critique.
Comment les Allemands sont-ils décrits dans les deux œuvres?
Dans les deux œuvres, les Allemands sont généralement dépeints comme autoritaires et parfois brutaux. Cependant, la perspective diffère: dans "Un sac de billes", la description est influencée par le point de vue d'un enfant, tandis que dans "Au revoir, les enfants", la description est plus objective.
Quel est le rôle de l'église dans les deux œuvres?
Dans les deux œuvres, l'église, à travers ses représentants (prêtres, moines), aide les protagonistes juifs. Ils offrent refuge, fournissent de faux papiers, et offrent une assistance en général. L'église est présentée comme s'interposant entre les Allemands et les Juifs par principe de charité.
Quelles sont les principales conclusions de l'analyse?
Le document conclut que malgré les différences de forme, les deux œuvres présentent des similitudes en termes de lieu, d'époque et de situation. Elles relatent toutes deux les expériences des auteurs pendant l'occupation et servent de rappel des atrocités subies par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Citation du texte
- Benjamin Fritz (Auteur), 2001, L`occupation de la France ( 1940-1944) Comparaison de Joseph Joffo "Un sac de billes" et de Louis Malle "Au revoir les enfants", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101860